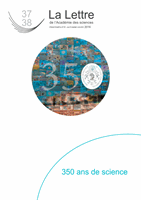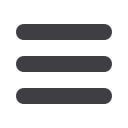

350
ANS
DE
SCIENCE
39
© cookiecutter - Fotolia
notre Académie l’existence d’une unité du plan d'organisation des espèces animales. Le système nerveux central
se trouve à la partie antérieure de ce plan. On sait aujourd’hui, en particulier grâce au travail pionnier de Nüsslein-
Volhard, que ce plan est déterminé par un réseau de gènes de régulation dits homéotiques. Leur mutation
entraîne des modifications spectaculaires telle, chez la mouche, la substitution d’une antenne par une patte.
Ces gènes interviennent bien dans la biogenèse du cerveau. Toutefois, le déchiffrage récent de la séquence
complète du génome crée un paradoxe de plus. De fait, si le génome de la levure contient environ 6 000 gènes
contre 13 000 chez la drosophile, il n’y a pas de variation du nombre de gènes codant pour des protéines de
la souris à l’homme – environ 25 000 – et, du chimpanzé à l’homme, la séquence totale des gènes codants
ne diffère que de 1,2 % ! La complexité anatomique et fonctionnelle du cerveau s’accroît donc beaucoup plus
rapidement que la complexité du génome. Une première hypothèse est que cette évolution résulte de la mutation
de quelques séquences régulatrices critiques contrôlant le développement du cerveau.
Le petit de l’homme naît avec un cerveau 5 fois plus léger que celui de l’adulte, et la période de maturation qui suit
la naissance est exceptionnellement longue comparée à celle d’autres espèces – elle dure plus de 15 ans. Près
de la moitié des synapses du cerveau adulte, de l’ordre du million de milliards, se forment après la naissance.
Pendant cette période, les apprentissages fondamentaux tels que l’acquisition de la marche, du langage ou
des interactions sociales prennent place. Se succèdent des phases d’exubérance synaptique et de variabilité
maximale, suivies de phases de sélection, avec stabilisation de certaines connexions et élimination des autres.
L’activité du réseau, spontanée ou déclenchée par l’environnement, règle ce processus de sélection synaptique,
« darwinienne » mais non génétique. Une variabilité apparaît même entre individus génétiquement identiques.
Comme nous l’avons suggéré, avec Courrège et Danchin, «
apprendre, c’est éliminer
». Du fait de cette intense
plasticité synaptique, une culture se développe, se transmet de génération en génération et se diversifie d’un
groupe social à l’autre. Des «
circuits culturels
» comme ceux de l’écriture et de la lecture, ou même des règles
éthiques, s’inscrivent dans le cerveau. Le cerveau de chaque individu «
internalise
», selon Vygotsky, les traits de
son environnement physique, social et culturel. Ainsi se développe la «
personne humaine
» avec son «
habitus
»
associé à l’histoire individuelle de chacun.
Cette approche physicaliste – cartésienne, puis darwinienne – conduirait-elle à faire
perdre à l’être humain une part de son humanité ? Rien n’est moins sûr. Ainsi,
Günther Anders nous dit «
Élargis ta capacité de représentation afin
de savoir ce que tu fais.
» (In
Nous, fils d’Eichmann, Rivages Éd.,
1999
) Les dispositions de notre cerveau, qui nous permettent de
progresser dans la connaissance de ce que nous sommes,
nous placent devant une lourde responsabilité éthique. À
nous d’inventer, avec notre cerveau, un futur qui nous fasse
accéder, selon Ricoeur, «
à une vie bonne avec et pour
les autres, dans des institutions justes
» (In
Soi-même
comme un autre, Seuil Éd., 1990
) et, j’ajouterai, dans un
environnement durable…