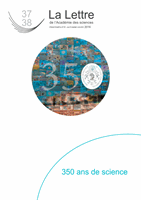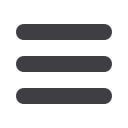
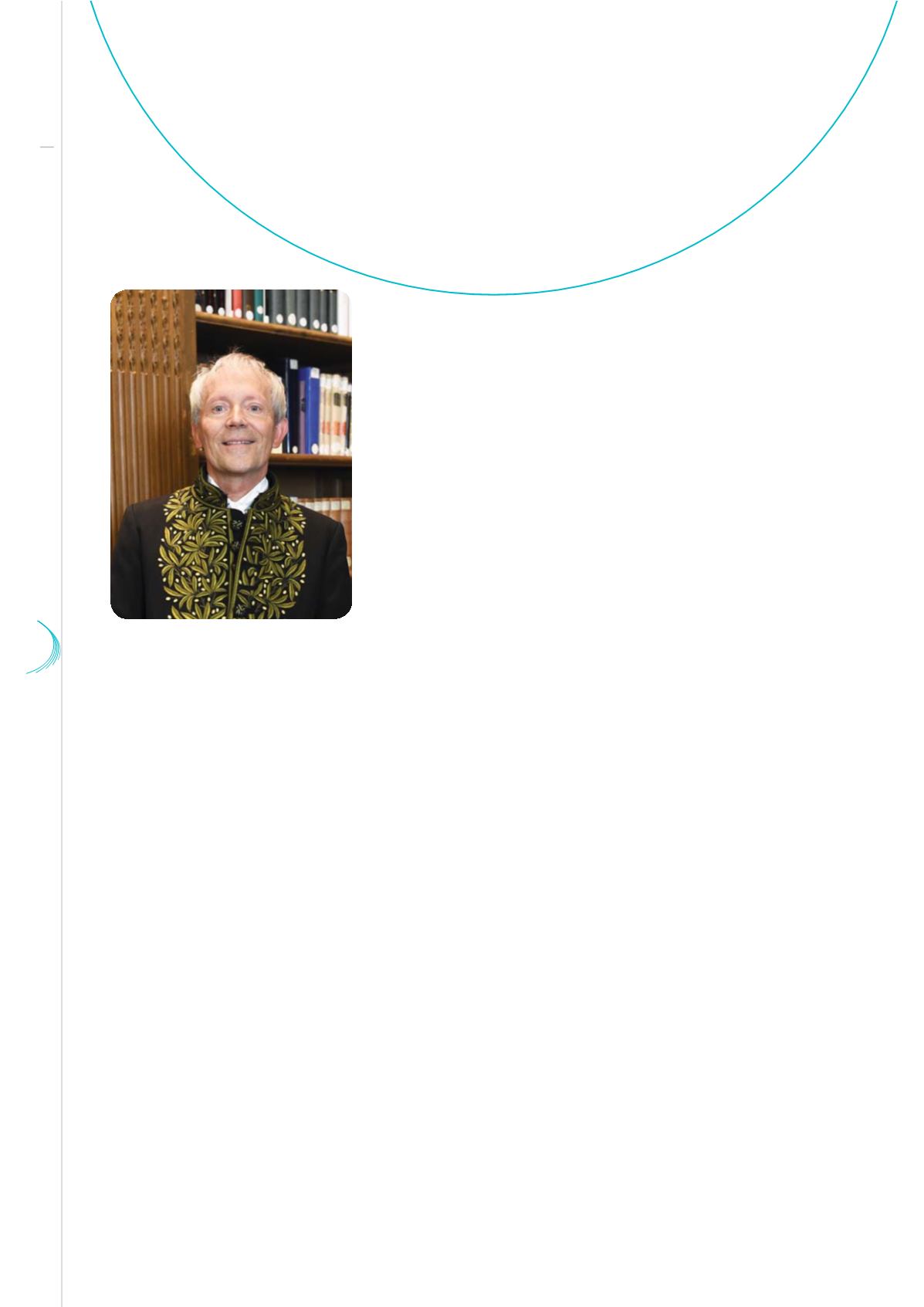
37 38
40
La Lettre
© B.Eymann - Académie des sciences
Yvon Le Maho
Membre de l’Académie des sciences – section
Biologie
intégrative
–, directeur de recherche émérite au CNRS, Institut
pluridisciplinaire Hubert-Curien, université de Strasbourg et
Centre scientifique de Monaco
Un moyen de traiter l’immense champ d’investigation
scientifique qui court de la cellule aux écosystèmes est
d’aborder la question des « modèles animaux ». On
appelle ainsi les animaux grâce auxquels on essaie de
comprendre comment fonctionne notre organisme et
comment lutter plus efficacement contre les maladies. Dans ce contexte, la biodiversité animale se
révèle une étonnante source d’innovations biomédicales. Invitation au voyage…
Modèles classiques
vs
modèles exotiques
Première étape : le désert du Kalahari, avec un animal étrange, le rat-taupe de Damara. En réalité, ce
n’est ni un rat, ni une taupe – il fait partie d’une famille proche du cochon d’Inde. Mais, en tant que modèle
animal pour la recherche biomédicale, c’est incontestablement un animal exotique. En effet, le modèle
« standard » est la souris : elle se multiplie rapidement et, comme elle est de petite taille, coûte moins
cher. On dispose aujourd’hui d’une palette de souris manipulées génétiquement permettant toutes sortes
d’approches dites « mécanistiques ». Mais la question clé est la pertinence du modèle animal utilisé. Pour
l’avoir ignoré, on s’est retrouvé avec la tragédie des malformations fœtales consécutives à la prise de
thalidomide par des femmes enceintes.
Revenons à la famille des rats-taupes. Ils sont tous d’une grande longévité, notamment le rat-taupe nu.
Moins photogénique que son congénère de Damara, il peut vivre 32 ans, soit 16 fois plus longtemps
qu’une souris. Or l’on a découvert qu’il est pourvu d’un mécanisme, inexistant chez la souris, qui empêche
la prolifération de cellules cancéreuses. L’éditorial de JM Sedivy, dans les Comptes Rendus de l’Académie
des Sciences américaine qui ont publié ces travaux en 2009, a alors questionné la pertinence de mettre
la quasi-totalité des moyens de la recherche sur l’animal standard : «
The situation is in some ways
De la cellule aux écosystèmes