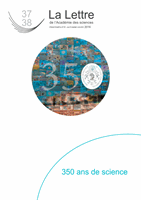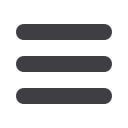
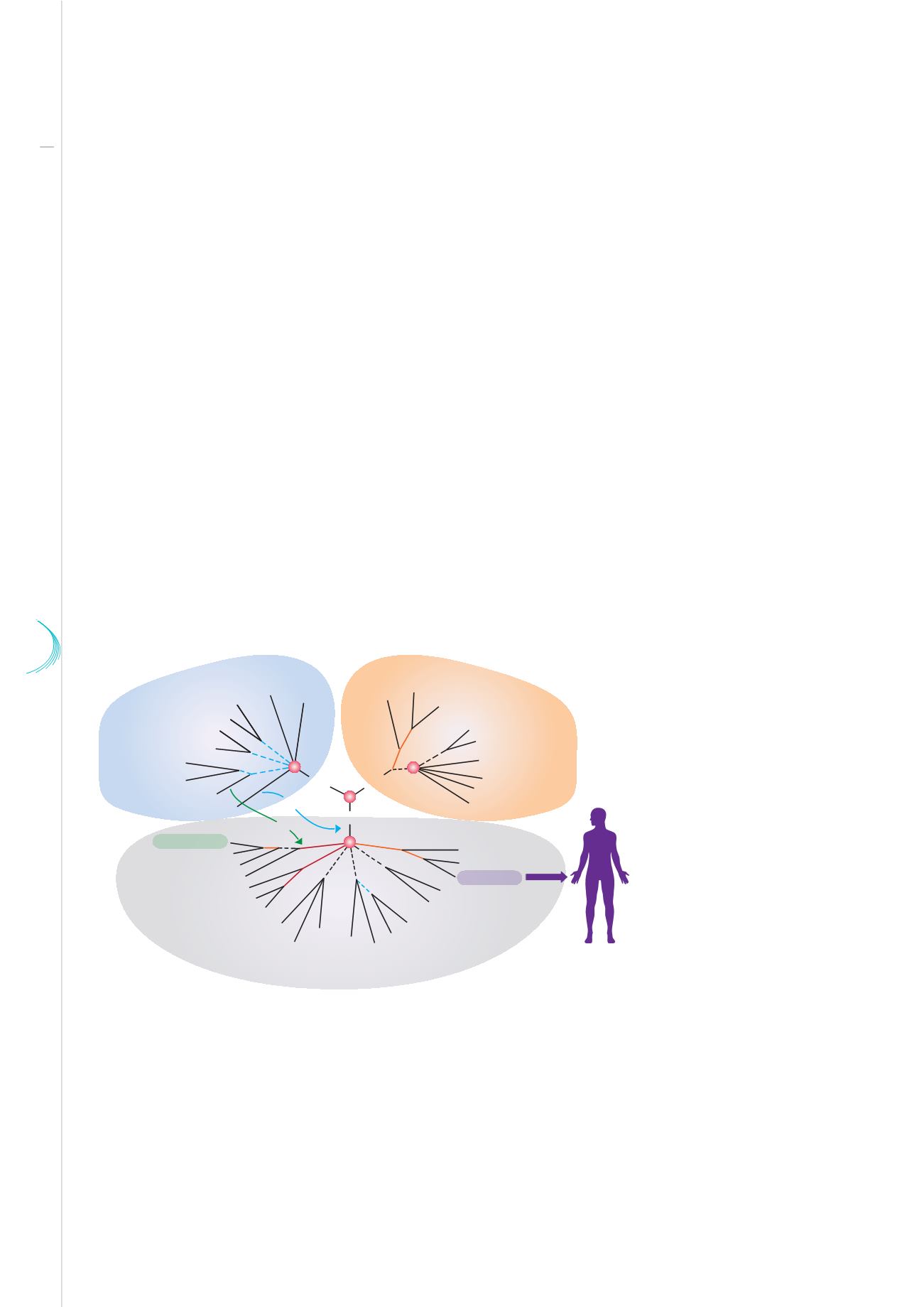
37 38
36
La Lettre
HOMO
ARCHÉES
BACTÉRIES
EUCARYOTES
Archées
Bactéries
Eucaryotes
Thermococcales
Méthanococcales
Archaeoglobales
Thermoplasmatales
Méthanosarcinales
Halobactériales
Euryarchaeota
Sulfolobales
Désulfurococcales
Thermo-
protéales
Crénarchaeota
Plancto-
mycétales
Gram positif
à bas GC
Thermotogales
Chlamydiales
Déinococcales
Gram positif
à haut HG
Cyanobactéries
Protéobactéries
Aquificales
Spirochètes
Mitochondries
Chloroplastes
Opisthokonta
Champignons
Choanoflagellés
Métazoaires
Radiolaires
Cercozoa
Rhizaires
Alvéolates
Straménopiles
Haptophytes
Chromalvéolates
Crypto-
phytes
Jakobids
Euglénoides
Diplomonades
Excavates
Embryophytes
Plantes
Amibozoaires
Algues vertes
Algues rouges
Glaucophytes
Mycétozoaires
Pélobionts
Entamoeba
© D'après F. Delsuc. Nat Rev Genet. 2005 ; 6 : 361-75
L’étude de la parenté génétique entre espèces vivantes (sur la base de l’ARN
ribosomique) révèle un arbre de la vie buissonnant où l’homme apparaît sur une
branche latérale.
Seconde étape : la biologie de la cellule et l’évolution
L’être vivant n’est pas simplement un sac d’enzymes : il possède une forme et une organisation. Au niveau le
plus élémentaire, on découvre la cellule, qui emmagasine protéines et acides nucléiques. Chez les organismes
supérieurs, un noyau se trouve au sein d’un cytoplasme aqueux, circonscrit par une membrane constituée de
lipides. «
Toute cellule provient d’une autre cellule
», propose Virchow dès 1855. Au cours du développement
de l’embryon, non seulement les cellules se multiplient, mais elles se différencient aussi en types distincts –
musculaire, hépatique, etc. Cette diversité microscopique s’inscrit dans une diversification plus générale de la
forme globale des êtres vivants.
Commencée avec Aristote, la description des espèces se développe au siècle des Lumières avec le Suédois
Linné et, chez nous, avec Buffon. Ces espèces sont classées de manière hiérarchique en un tableau illustrant
une «
perfection croissante
». Au sommet siègent l’homme, puis le Créateur, auteur de cette harmonieuse «
scala
naturae
». Le tableau est fixe et immuable, jusqu’à ce que Lamarck, le 11 mai 1800, dans le discours d’ouverture
de son cours au Muséum d’histoire naturelle, abandonne cette vision du monde au bénéfice du concept
révolutionnaire de l’évolution des espèces : celles-ci ne sont pas fixes, elles se «
transforment
». Darwin, 59 ans
plus tard, reprend la thèse transformiste mais abandonne l’hérédité des caractères acquis de Lamarck au bénéfice
de la sélection naturelle comme mécanisme de l’évolution. Deux siècles de recherches biologiques valideront le
modèle darwinien. L’étude des fossiles montre que des espèces, voire des groupes entiers, sont apparus puis ont,
en grande partie, disparu. La mort devient le rouage essentiel de l’évolution de la vie. Inattendus, des transferts
de gènes entre espèces
parfois très éloignées ont lieu,
et l’arbre de la vie devient
aléatoire et irrégulier. Il prend
la forme d’un buisson où les
ancêtres d’
Homo sapiens
apparaissent sur une branche
latérale : l’homme ne trône
plus au sommet de l’échelle
des êtres.
Les développements d’une
discipline
nouvelle,
la
génétique, va révéler des
liens indissolubles entre
évolution et développement.
Dès 1866, Mendel reconnaît l’existence de caractères héréditaires stables et transmissibles – comme la couleur
et la forme des pois qu’il cultive dans le jardin de son monastère –, qu’il assigne à des «
facteurs
» invisibles
appelés depuis gènes. Morgan, dans les années 1920, démontre chez la mouche que ces gènes sont localisés
sur les chromosomes présents dans le noyau cellulaire. Ils sont susceptibles d’être modifiés par des mutations
transmissibles par l’hérédité. La biologie moléculaire établit que chaque protéine de l’organisme est codée
par une séquence génique de la molécule d’ADN, et que des mutations de ces séquences sont à l’origine