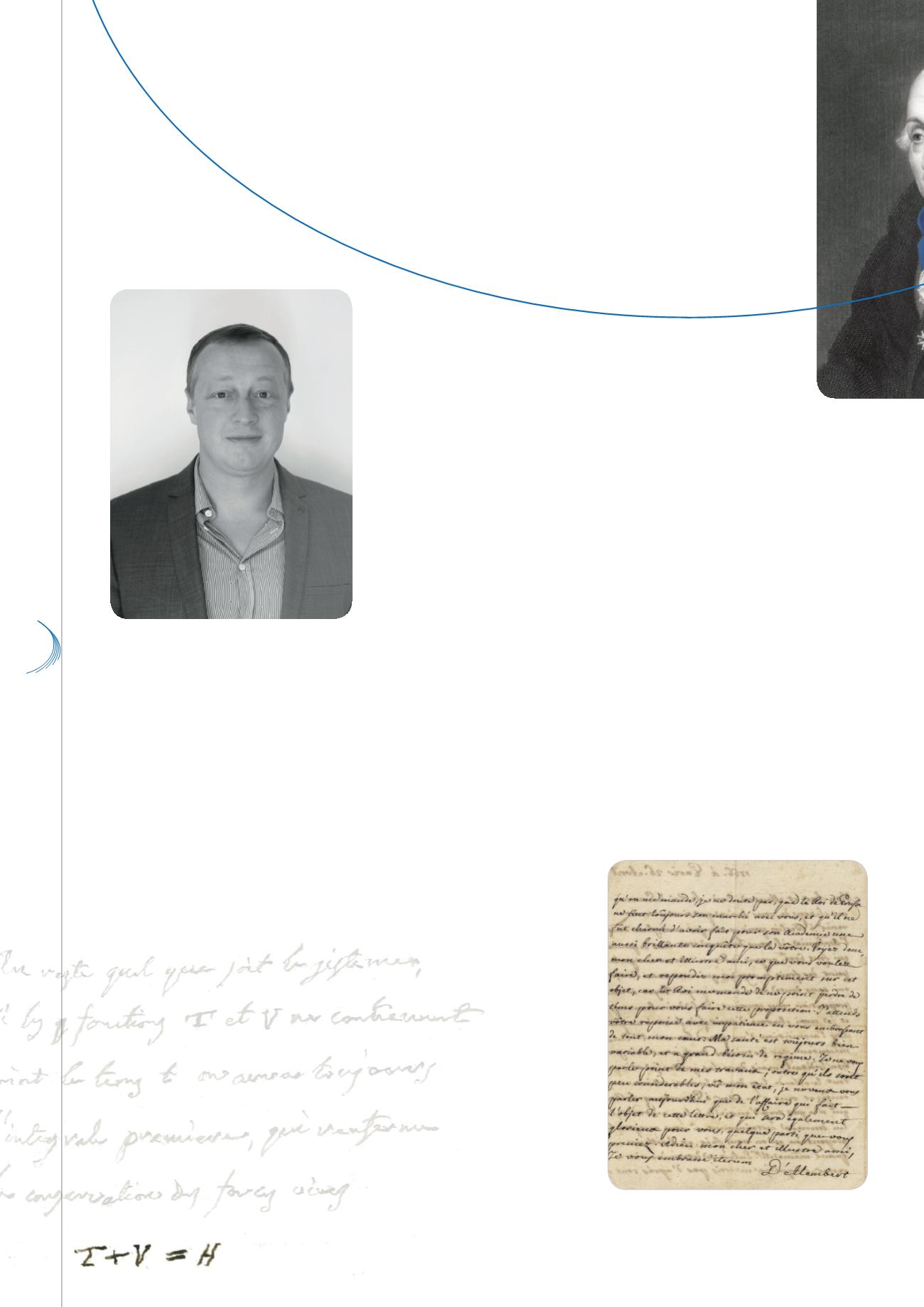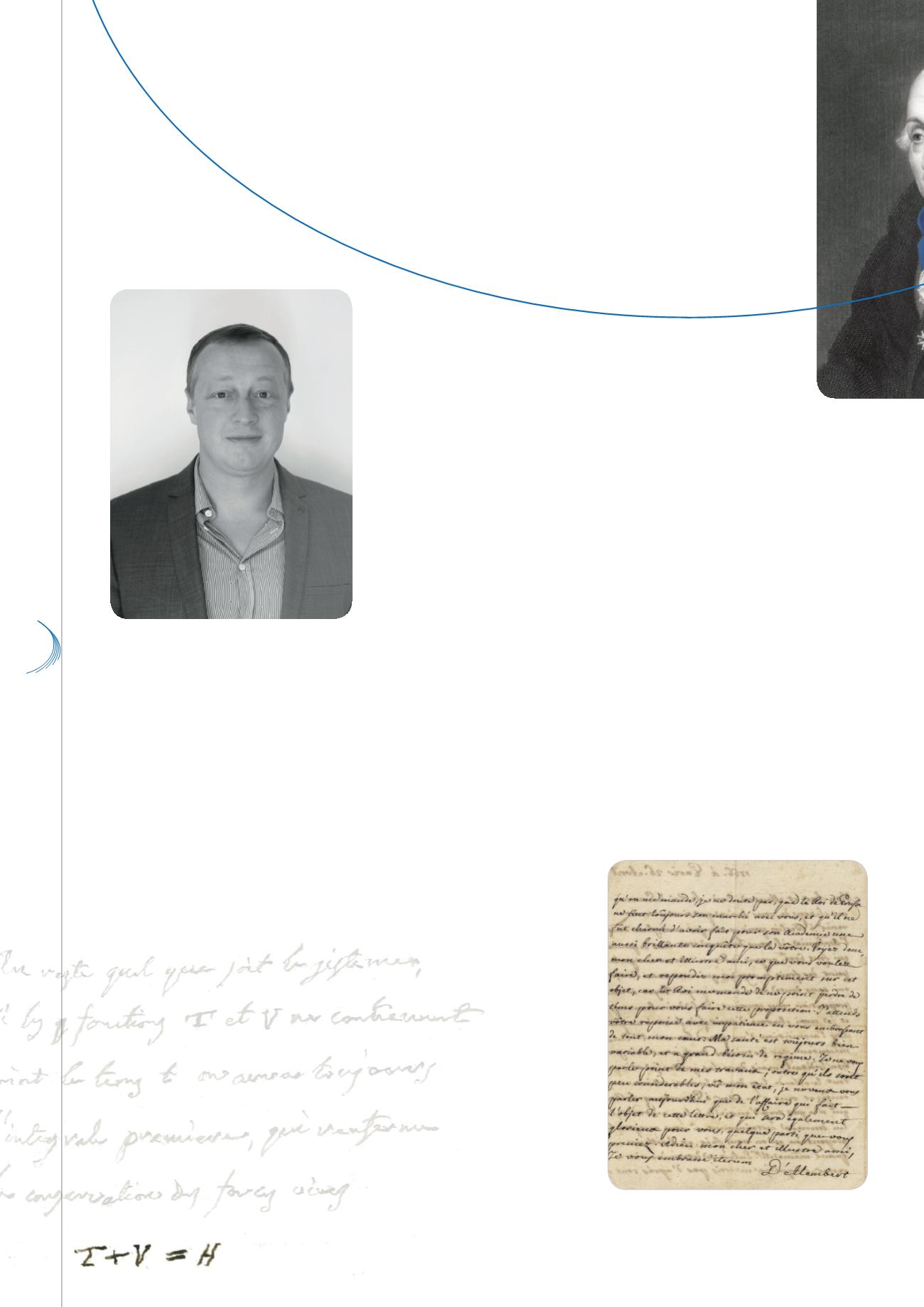
Lettre manuscrite d’Euler © Collections École polytechnique - Palaiseau
33
30
La Lettre
© DR
© Collections École polytechnique - Palaiseau
Lettre de d’Alembert à Lagrange
(26 avril 1766)
Frédéric Brechenmacher
LinX
- Département
Humanités et sciences sociales
,
École polytechnique
L’histoire et les travaux de Lagrange incitent à mettre
en perspective les relations entre les mathématiques
et d’autres branches du savoir et, par là-même, à
esquisser quelques traits de la dynamique historique des
mathématiques, entre créativité individuelle et pratiques
collectives.
Le grand mathématicien Joseph-Louis Lagrange (1736-
1813) est aujourd’hui moins connu que d’autres savants du siècle des Lumières, si ce n’est pour avoir
banni de ses écrits toute figure géométrique à une époque qui donnait le nom de
géomètre
à ses
mathématiciens. Pourtant, lagrangiens, théorème de Lagrange ou points de Lagrange accompagnent
quotidiennement des travaux de mécanique, de géométrie ou d’algèbre.
Un espace européen des sciences
Turin, Berlin, Paris, etc. Ces lieux habités par Lagrange sont
comme un écho aux espoirs placés aujourd’hui dans la construc-
tion européenne. Mais, pas plus au XVIII
e
siècle qu’aujourd’hui,
la créativité d’un savant ne se réduit aux lieux géographiques
dans lesquels il l’exerce. Où Lagrange apprend-il les mathé-
matiques ? Au collège de Turin, bien entendu, mais aussi dans
les ouvrages des maîtres du calcul différentiel comme Newton
ou Halley. À qui, ou avec qui, parle-t-il de mécanique ? À ses
élèves de l’École d’artillerie, où il enseigne à partir de l’âge de
19 ans, mais surtout avec d’autres savants disséminés à travers
l’Europe.
Lagrange,
géomètre sans figure ?