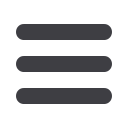

35 36
46
La Lettre
Exemples de manipulations de la lumière utilisées dans des lasers récents
A. Un long trajet dans un morceau de verre - obtenu ici par de multiples réflexions, comme dans un billard - permet de modifier la phase spectrale, par
exemple pour allonger la durée de l’impulsion laser.
B. Une impulsion laser (IN) interagit dans un cristal de paratellurite (TeO2) avec une impulsion acoustique (recouvrant le rayon laser jaune ), produisant
en sortie (OUT) une impulsion diffractée sur laquelle la phase de l’onde acoustique est « imprimée ». On peut ainsi programmer la phase spectrale
des impulsions ultracourtes.
C. L’interaction, dans un petit cristal de niobate de lithium, d’une impulsion laser à très forte énergie (flèche rouge), mais à bande spectrale étroite, avec
une impulsion laser plus faible (flèche bleue avec un dégradé), mais à bande spectrale très large, produit par effet non linéaire une impulsion à la fois
de très forte énergie et de bande très large, qui peut alors produire une impulsion ultracourte de très forte intensité.
A
B
C
© yang yu - Fotolia
© suns07butterfly - Fotolia
Des progrès permanents
La faible durée et la forte puissance des lasers constituent
à la fois une bénédiction et un cauchemar. De fait, la
traversée de tout matériau, même sous certaines conditions
d’air ambiant, a pour effet de changer la phase relative des
diverses couleurs (phase spectrale) et de détruire ainsi leur
cohérence. Une des clés de l’émission d’impulsions courtes
est donc de parvenir à un contrôle stable et précis de la phase
spectrale. Par ailleurs, le comportement optique des matériaux à ces
niveaux de puissance est fortement non linéaire, produisant des effets
tels que la production de nouvelles fréquences, le rouge produisant ainsi du bleu.
Scientifiques et industriels ont appris à gérer ces défauts : par exemple, on sait qu’il faut étaler la durée
des impulsions avant amplification, puis les comprimer avec une précision extrême pour produire des
impulsions de forte puissance par amplification. Malgré tout, si les lasers de durée de quelques centaines
de femtosecondes sont aujourd’hui des objets simples et robustes, ils restent, pour des durées inférieures,
des « bêtes » de laboratoire.
Cette situation commence à trouver son issue grâce à la combinaison d’innovations permettant notamment
de réaliser les opérations de production et d’amplification dans des milieux solides, puis de transférer
l’énergie des lasers robustes aux impulsions très courtes par amplification paramétrique : c’est ainsi que
plutôt que de combattre la non-linéarité, on l’utilise.
Pour tous ces développements, des programmes européens tels qu’ELI (
Extreme Light Infrastructure
),
qui visent l’obtention de puissances extrêmes (de l’ordre de l’exawatt, soit 10
18
watts) aux durées
femtosecondes, jouent actuellement le rôle que la Formule 1, en son temps, a joué pour le développement,
en général, de l’automobile...


















