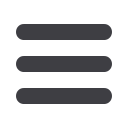
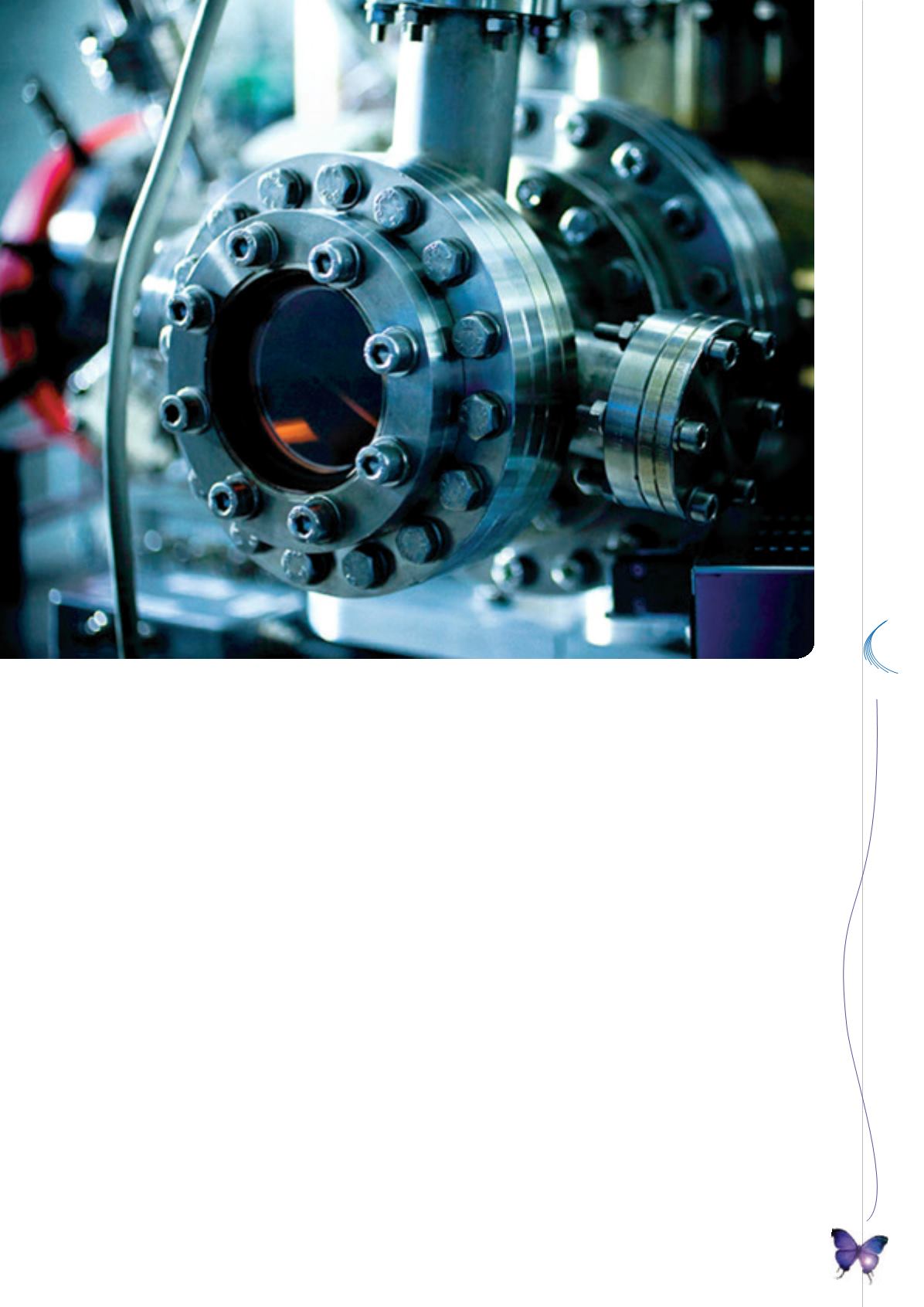
D
ossier
49
© suns07butterfly - Fotolia
© Éric Ramahatra
Extérieur d'une chambre à vide où sont détectés les électrons
externes (les plus éloignées du noyau). Leur durée est comparable au temps caractéristique de l’effet
photoélectrique - émission d’électrons par un matériau soumis à un rayonnement lumineux - ou du
réarrangement du nuage électronique d’un atome ou d’une molécule après excitation. Les impulsions
attosecondes jouent le rôle de flashs d’une caméra ultrarapide qui filme le mouvement des électrons
dans la matière. L’absorption d’une impulsion démarre un processus (une ionisation ou une réaction
chimique, par exemple), et l’absorption d’une seconde impulsion, retardée par rapport à la première, le
stoppe. Les caractéristiques des particules émises varient avec le retard entre les deux impulsions et nous
renseignent sur la dynamique temporelle du processus étudié.
Néanmoins, il faut se rappeler que nous sommes dans le domaine de la mécanique quantique. Les
électrons en mouvement sont aussi des ondes, ou plus exactement des paquets d’onde (dualité onde-
corpuscule). Les caractériser implique la mesure de leur amplitude et de leur phase. Cette dernière est
rendue accessible par des techniques interférométriques utilisant des impulsions attosecondes. On
se rapproche doucement d’un de nos rêves de physicien : suivre en temps réel l’évolution du nuage
électronique mis en mouvement par une perturbation. Que va-t-on voir ?


















