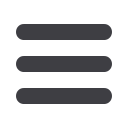
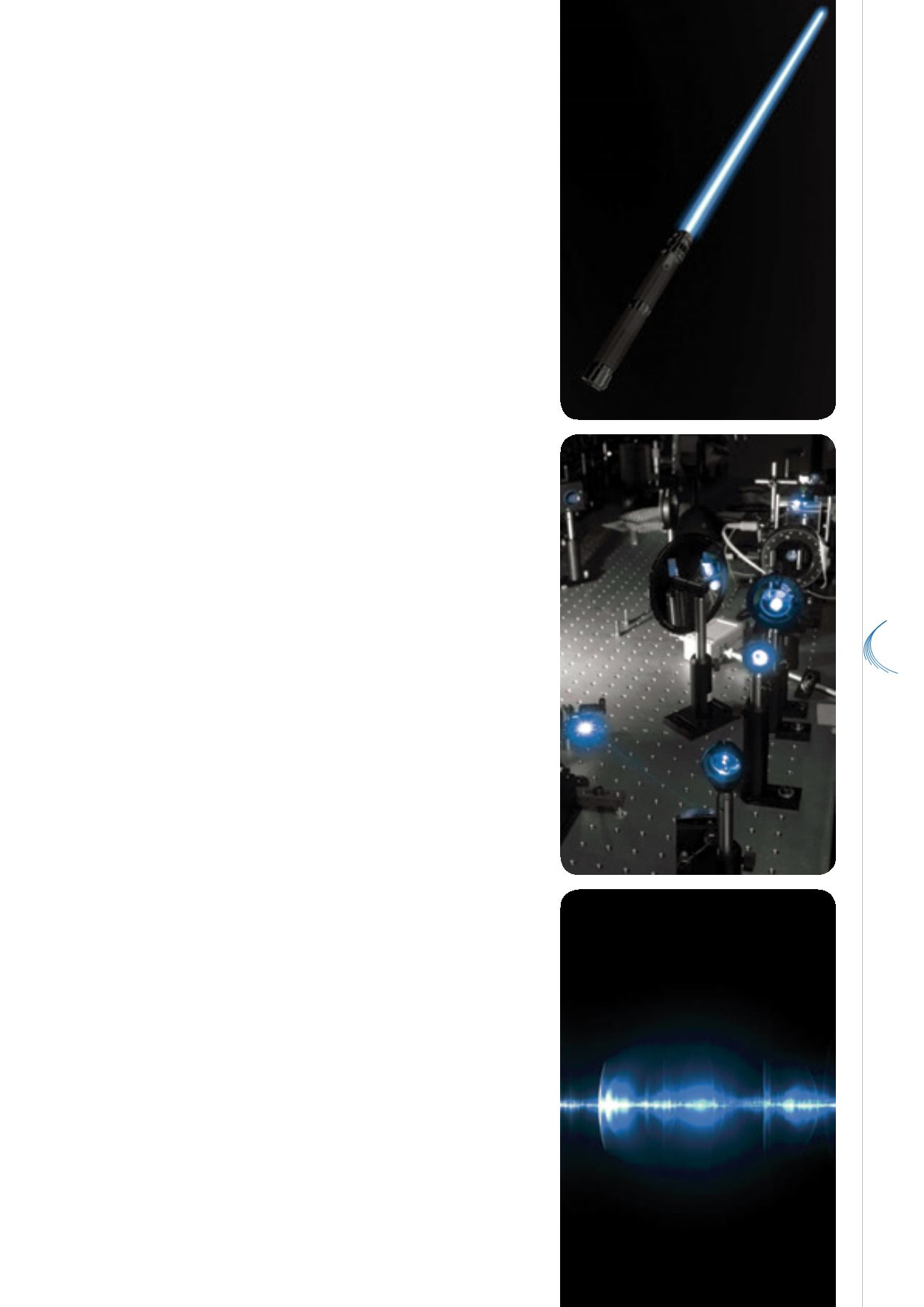
D
ossier
45
© Oleksiy Mark - Fotolia
© ArTo - Fotolia
© Filip Falta - Fotolia
Le procédé pour produire cet instant magique t0 a été
démontré en 1963, quelques années seulement après la
réalisation du premier laser (1960). Pour produire un large
spectre de couleurs, on a d’abord utilisé comme milieu laser
des solutions contenant une gamme de colorants liquides,
qui ont été progressivement remplacés par des matériaux
solides, tels que les cristaux de saphir dopés au titane.
Des applications spectaculaires
Les lasers ultracourts sont principalement utilisés :
●
comme « flash », afin de réaliser des instantanés (image
ou phénomène physique) à l’échelle des mouvements
atomiques (vibrations des atomes) ;
●
comme
source
de
puissance
instantanée
exceptionnelle : on peut ainsi monter sur un banc de
laboratoire un laser délivrant une puissance électrique
instantanée équivalant à l’ensemble de la puissance
électrique produite dans le monde !
Ils ont différentes applications, pour certaines très
spectaculaires :
●
accélération de particules par des champs intenses
photogénérés, comme par exemple la production de
protons pour la radiothérapie ;
●
optimisation de la fusion inertielle par laser : un laser
secondaire femtoseconde aide le laser principal
nanoseconde à initier la réaction, comme une allumette ;
●
métrologie des fréquences optiques utilisant des trains
d’impulsions de durées ultracourtes (
voir p 38
) ;
●
usinage et chirurgie par laser : la matière est éjectée
instantanément sans effet thermique. Le laser
femtoseconde est ainsi une alternative au scalpel pour
les opérations de la myopie.


















