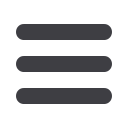
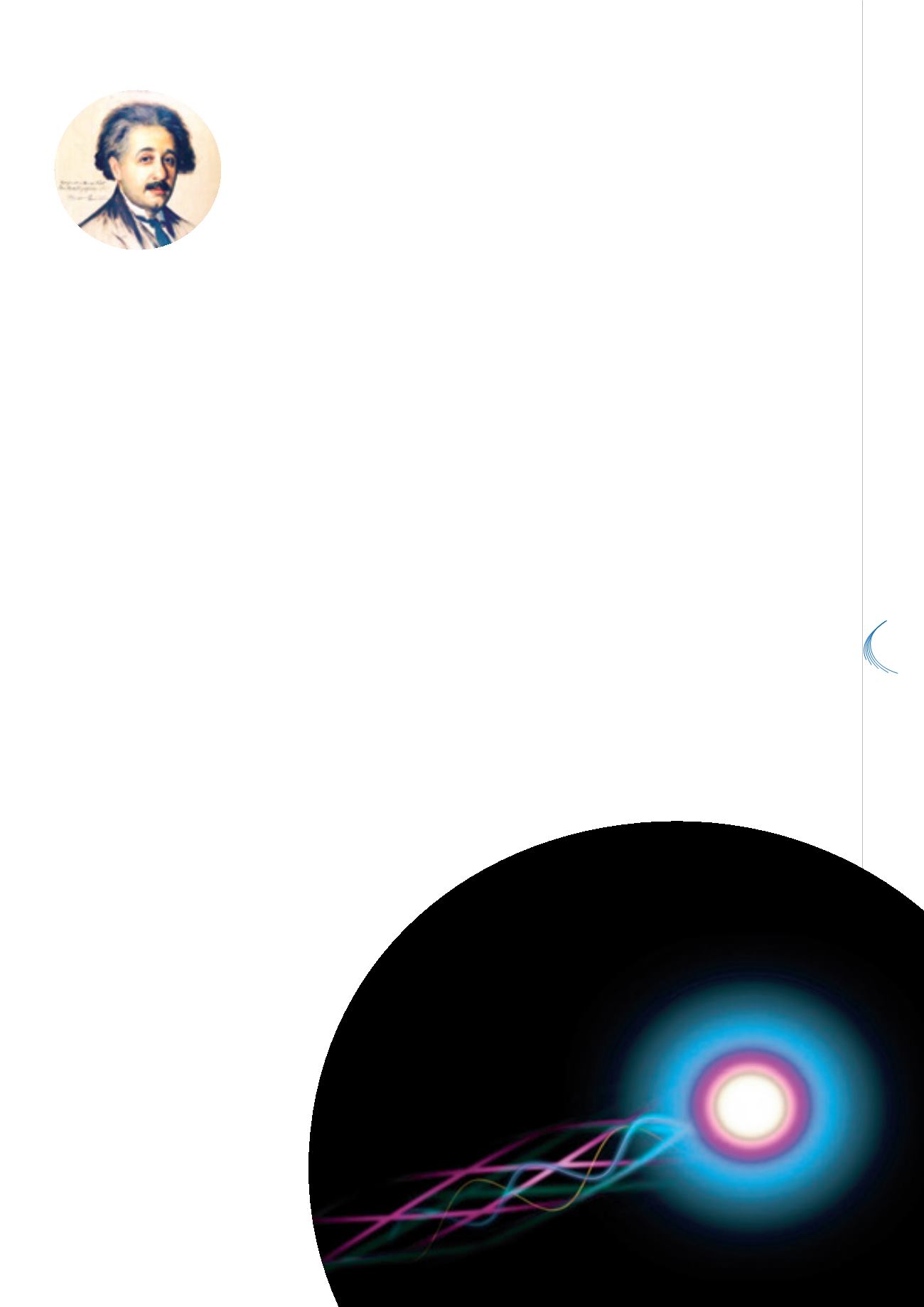
D
ossier
21
Portrait d’Albert Einstein
peint par Max Wulfart en
1921
© DR
© Tommroch - Fotolia
inconnue au moment de l’extraordinaire série de mémoires de Fresnel
1
, publiés entre
1815 et 1822, qui donnent une vue complète de toute l’optique classique, encore
valable aujourd’hui. Le triomphe de la théorie ondulatoire de la lumière sera
parachevé un demi-siècle plus tard, lorsque Maxwell découvrira la nature jusque
là inconnue des ondes de Fresnel : ce sont des ondes électromagnétiques.
Le modèle corpusculaire de la lumière proposé par Einstein est antinomique avec le
modèle ondulatoire, dont le succès est immense. D’où la réticence des grands physiciens
de l’époque, bien résumée dans une lettre de Planck, Nernst, Rubens et Warburg, écrite en 1913
pour soutenir l’élection d’Einstein à l’Académie des sciences de Berlin. On peut y lire : «
En bref, on peut
dire que parmi les grands problèmes dont la physique moderne abonde, il n’en est guère qu’Einstein n’ait
marqué de sa contribution. Il est vrai qu’il a parfois manqué le but lors de ses spéculations, par exemple
avec son hypothèse des quanta lumineux ; mais on ne saurait lui en faire le reproche, car il n’est pas
possible d’introduire des idées réellement nouvelles, même dans les sciences les plus exactes, sans
parfois prendre des risques
2
. »
Einstein était bien sûr conscient du problème posé par l’incompatibilité entre ses quanta de lumière et
l’ensemble des comportements ondulatoires observés en optique. Il aborde cette question difficile dans
une conférence donnée à Salzbourg en 1909. Après la discussion d’une incroyable « expérience de
pensée » dans laquelle coexistent les comportements ondulatoires et corpusculaires, Einstein rappelle
que les phénomènes d’interférence et de diffraction obligent à concevoir la lumière comme une onde, puis
il continue :
« Il est […] indéniable qu’il existe un ensemble important de faits relatifs au rayonnement qui
indiquent que la lumière possède certaines propriétés fondamentales que l’on comprend beaucoup mieux
en adoptant le point de vue de la théorie Newtonienne de l’émission de la lumière que celui de la théorie
ondulatoire. C’est pourquoi je pense que la prochaine étape du développement de la physique théorique
nous fournira une théorie de la lumière que l’on pourra interpréter comme une sorte de fusion de la théorie
ondulatoire et de la théorie de l’émission de la lumière.»
Comment ne pas être époustouflé devant
cette lucidité d’Einstein, qui introduit
explicitement la notion de dualité
onde-corpuscule, quatre ans
avant que Bohr ne développe
son
modèle
d’atome
quantifié, qui ne trouvera
sa justification que dans la
dualité onde-corpuscule
des électrons, proposée
en 1923 par Louis de
Broglie. C’est donc
en réfléchissant aux


















