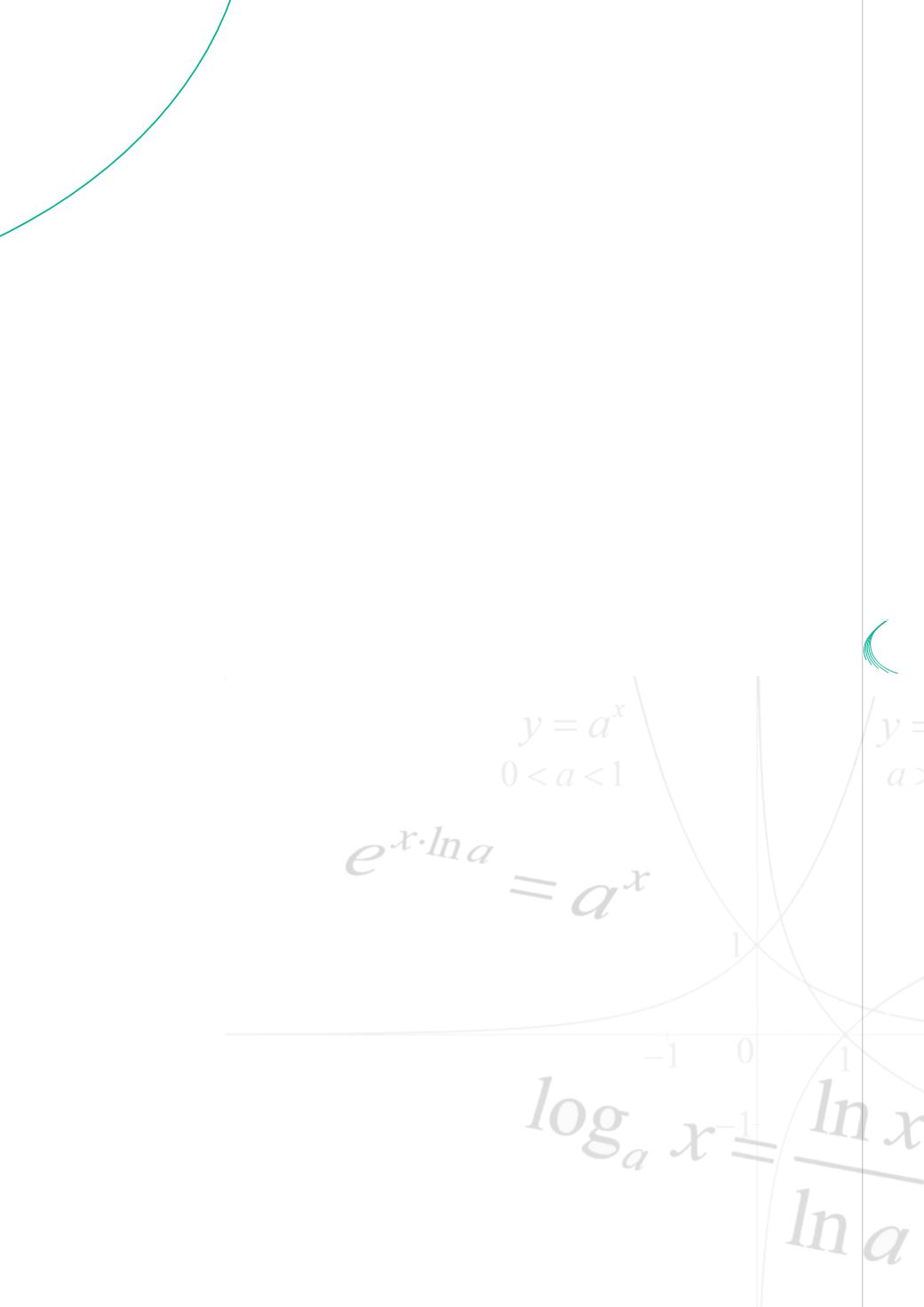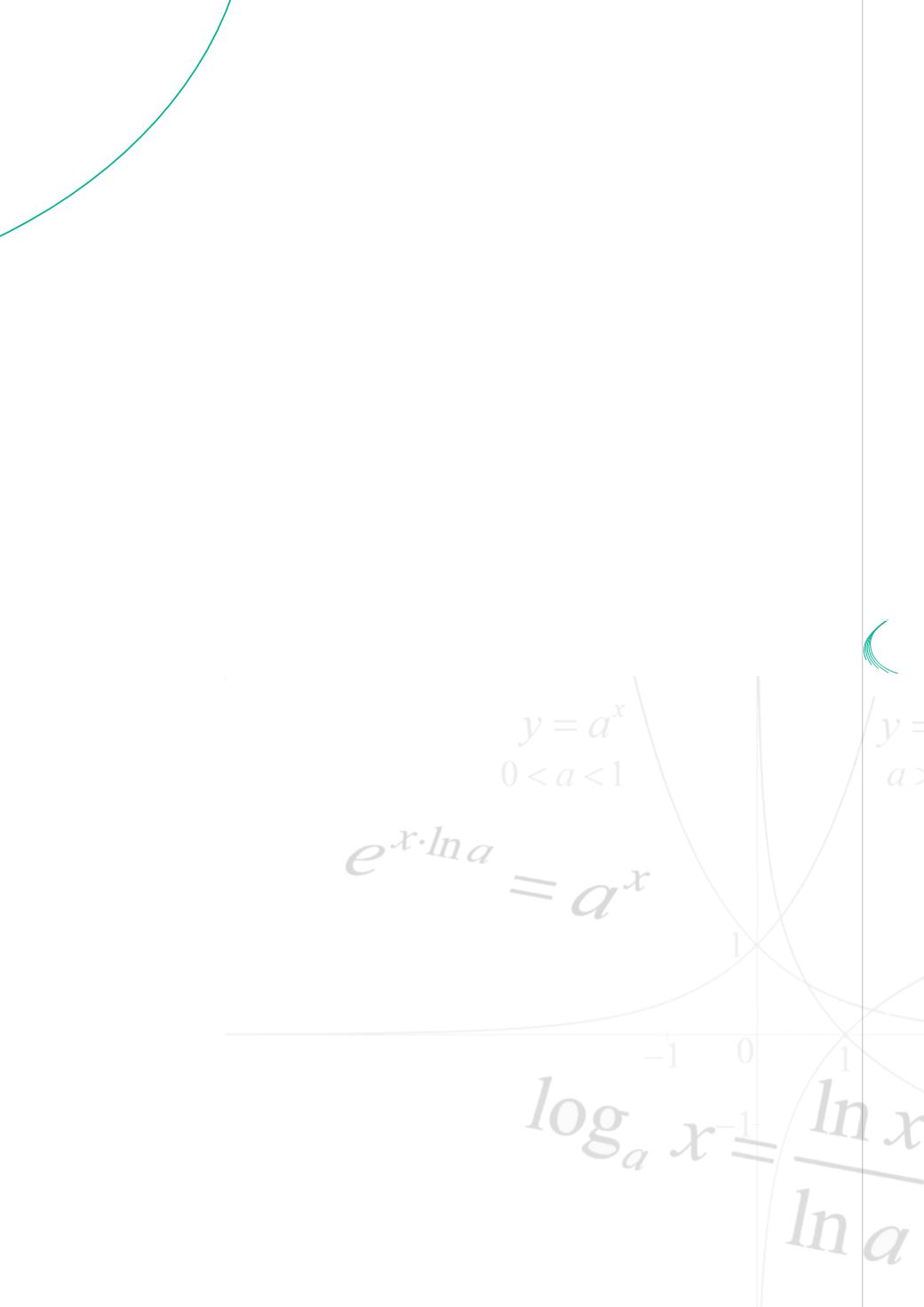
É
ditorial
5
© Thomas N. - Fotolia
la géométrie, aux équations et aux probabilités, et a engendré de fructueux débats entre élèves et
professeurs. La pérennité de notre recherche en mathématiques dépend en premier lieu de la
place que les programmes voudront bien continuer à accorder aux mathématiques dans l’enseignement
scolaire. Ensuite, les politiques scientifiques adoptées par les grands organismes de recherche, en
favorisant la recherche à temps plein pour des mathématiciens en début de carrière, ont probablement
également concouru à la préservation de la notoriété des mathématiques françaises. Cet équilibre fragile,
qui donne à notre pays un rôle mondial important dans le développement du savoir, doit incontestable-
ment être protégé.
Dans
Retour sur l’actualité
, Bernard Meunier, vice-président de l’Académie, revient sur la nécessité
de préserver la liberté de recherche en France. Ce plaidoyer est loin d’être vain quand émergent des
signaux qui, ici ou là, sur les organismes génétiquement modifiés ou sur la recherche de nouvelles sources
d’énergie, suggèrent que cette liberté est réellement menacée. Or cette liberté est essentielle à la produc-
tion de nouveaux savoirs fondamentaux, qui seront les uns ou les autres, un jour, à l’origine de grandes
avancées scientifiques. Par ailleurs, les sciences sont aussi un formidable vecteur de progrès social et de
croissance économique : n’ayons pas peur d’elles !
Enfin, la
Vie de l’Académie
présente les nouveaux membres élus en 2013, dix-sept scientifiques - sept
femmes et dix hommes - solennellement reçus le 17 juin 2014, par leurs pairs, sous la coupole de
l’Institut de France. Comme le prévoient les statuts de l’Académie, la moitié des nouveaux académiciens
ont moins de 55 ans : ils sont un formidable atout pour maintenir l’Académie tournée vers l’avenir et lui
permettre de répondre, toujours mieux, aux questions que pose à juste titre la société face au développe-
ment des sciences et de leurs applications.
Pour conclure, je citerai une phrase de Victor Hugo tirée des dernières pages de
Claude Gueux
, paru
en 1834. Après l’exécution de celui-ci, une réflexion s’établit sur deux questions de société, celle de la
pénalité et celle de l’éducation : «
Quand la France saura lire, ne laissez pas sans direction cette
intelligence que vous aurez développée. Ce serait un autre désordre. L’ignorance vaut encore mieux
que la mauvaise science
. » Il est vrai, l’ignorance peut être combattue par l’éducation, mais la mauvaise
science engendre l’idéologie et rend arrogant et nuisible celui qui s’en sert.