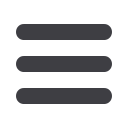
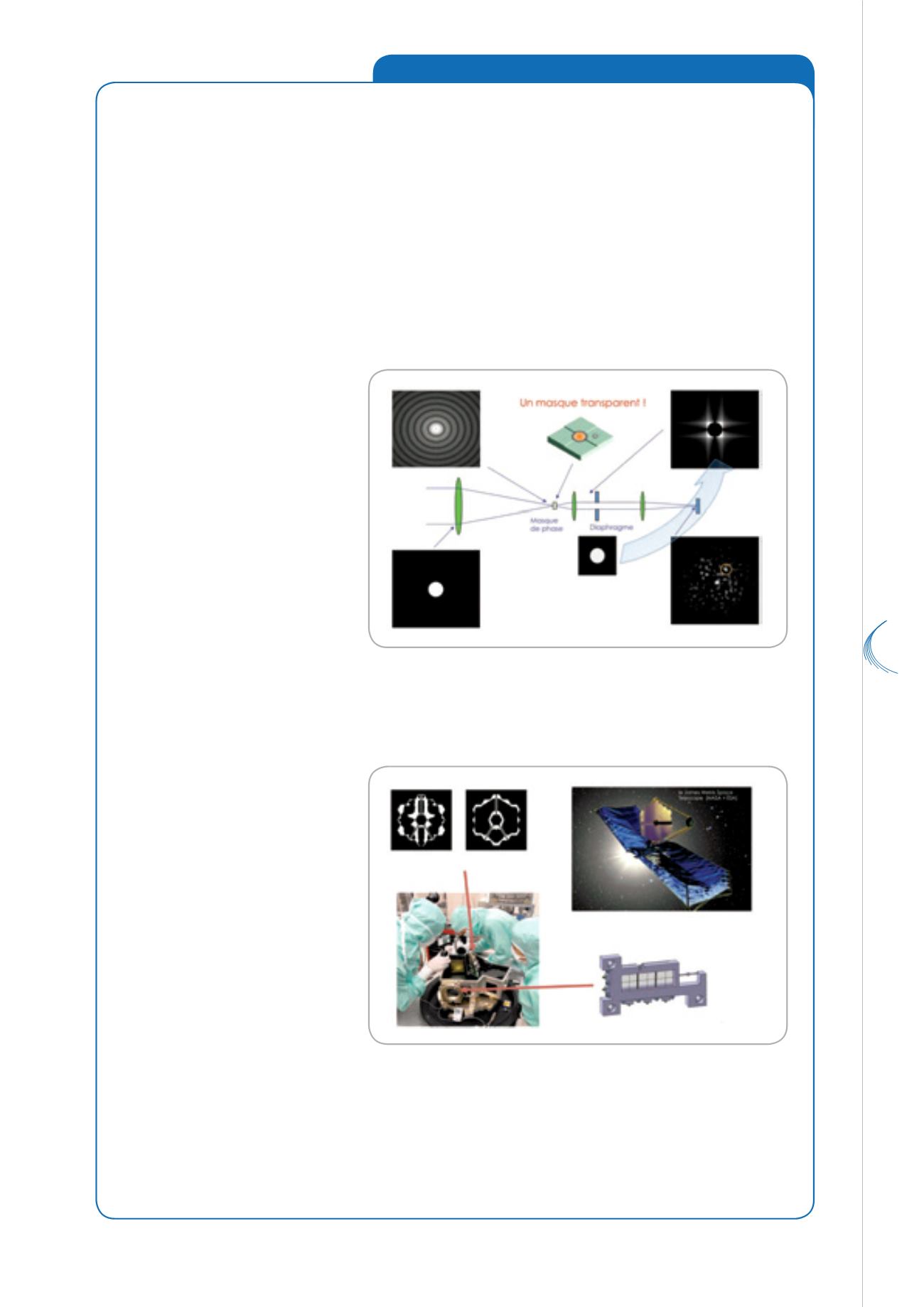
D
ossier
39
Pour observer la couronne solaire hors des périodes d’éclipse totale, l’astronome et académicien français
Bernard Lyot a inventé un procédé permettant de réduire considérablement la lumière du disque solaire,
diffractée et diffusée par les défauts de l’optique. Sa solution ? Combiner deux masques spécifiques, l'un
dans le plan image, et l'autre dans le plan pupille du télescope.
La coronographie stellaire moderne, qui cherche à faire l'imagerie directe de planètes extrasolaires en
orbite autour d'une étoile, s'inspire de cette idée en la généralisant. De nombreuses combinaisons ont
été proposées, dans les deux plans image et pupille et avec des masques de toutes natures (de phase,
d'amplitude, opaque, dégradé, apodisant, asymétrique). Les performances sont désormais excellentes
et s'approchent du taux de rejet de
la lumière stellaire que réclame le
contraste considérable qui existe
entre une planète et son étoile -
10
10
, par exemple, pour la Terre
par rapport au Soleil !
Dans tous les cas, un prérequis
est l'obtention d'un degré de
cohérence le plus élevé possible
de la lumière, car les principes
mis en jeu ont finalement tous
pour objectif d’obtenir un effet
d'interférence destructive sur la
lumière provenant de l'étoile, tout
l'art résidant, ensuite, dans le
système astucieux permettant à la
lumière de la planète d'échapper
à cet effet. Cette cohérence est
obtenue au sol grâce à l'optique
adaptative, et dans l'espace
grâce à des optiques de grande
qualité. Un exemple de dispositif
coronographique
combinant
masques en plan image et en
plan pupillaire est celui du jeu
de coronographes à quatre-
quadrants équipant la caméra
infrarouge européenne MIRI (
Mid
Infrared Instrument
), installée à
bord du télescope spatial James
Webb, de 6,5 m de diamètre, qui
sera lancé en 2018.
Éteindre les étoiles pour observer les exoplanètes
Coronographe à masque de phase quatre-quadrants
Différentes images des plans objet et pupille au long du faisceau sont indiquées.
Le masque de phase (au centre) rejette à l'extérieur de la pupille géométrique
la lumière de l'étoile (en haut à droite), qui est alors bloquée par un diaphragme
(grande flèche incurvée). L'image d'un objet proche de l'étoile peut alors être
révélée (en bas à droite : cercle orange).
© Daniel Rouan
La caméra infrarouge MIRI sur le télescope spatial James Webb
La caméra, qui sera installée au foyer du télescope, est équipée de 3 masques
coronographiques quatre-quadrants (en bas à droite) et de diaphragmes
pupillaires dentelés (en haut à gauche). Le masque en plan image est parfaitement
transparent et a la structure illustrée dans le schéma supérieur, où deux des
quadrants introduisent un déphasage de π de l'onde. Quand l'étoile est exactement
au centre, l'amplitude complexe s'annule, ce qui se traduit par une expulsion de
toute la lumière stellaire à l'extérieur de l'image de la pupille. Un masque pupillaire
opaque, très dentelé dans le cas du coronographe de MIRI, bloque alors cette
lumière.
© Daniel Rouan


















