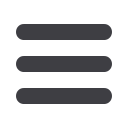
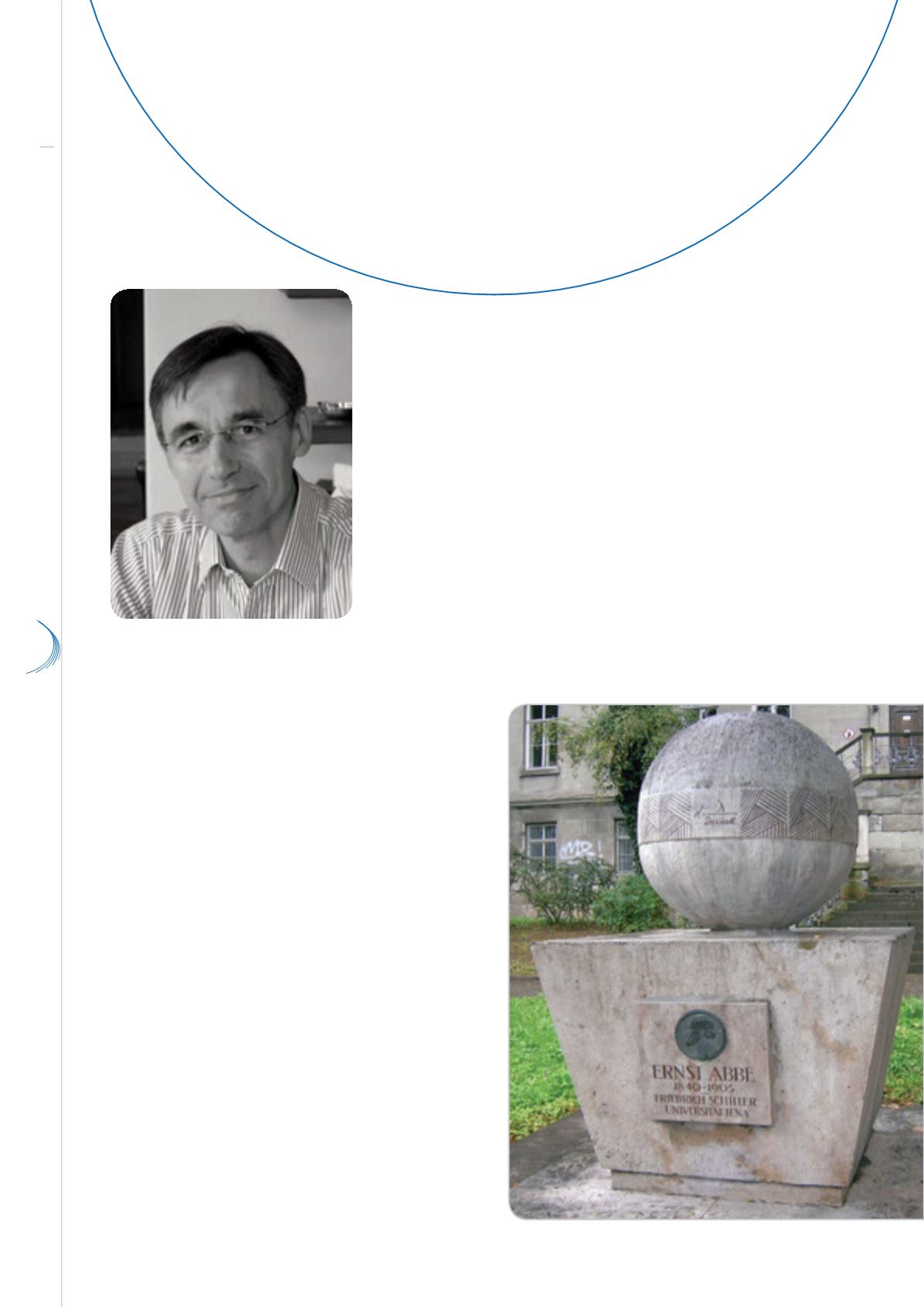
35 36
28
La Lettre
© DR
Monument commémorant la découverte, par Abbe, de
la limite de résolution
d
des microscopes optiques (Iéna,
Allemagne)
© Jean-Jacques Greffet
Jean-Jacques Greffet
Laboratoire Charles-Fabry, Institut d’Optique Graduate School,
CNRS, Université Paris-Sud, Orsay
Le terme nanophotonique, apparu il y a une quinzaine
d’années, désigne les développements de l’optique à
l’échelle du nanomètre. Pourquoi cette échelle joue-t-elle
un rôle particulier ? Pourquoi parle-t-on de nanosciences,
et jamais de kilosciences ou de millisciences ? Les lois
physiques décrivant le comportement de la matière
sont en fait valables pour des objets dont la taille est
supérieure à quelques nanomètres, mais cessent
très souvent de l’être en deçà : cela ouvre un champ
de recherche pour comprendre ce qui régit
les phénomènes à ces échelles où les effets
quantiques deviennent importants. Cela ouvre
également un champ d’applications technologiques
puisque les nanosystèmes, étant régis par des lois
différentes, sont susceptibles d’offrir de nouvelles
fonctionnalités. Il est impossible de citer toutes les
ruptures de paradigme qui sont intervenues depuis
une quinzaine d’années, mais trois exemples
illustrent bien le caractère interdisciplinaire de la
nanophotonique.
L’imagerie super-résolue
L’un des premiers résultats obtenus dans le domaine
de la nanophotonique concerne ce que l’on appelle
la limite de diffraction. Depuis Ernst Abbe, on sait
que l’on ne peut pas faire d’image de microscopie
optique permettant de séparer des objets séparés
par des distances inférieures à la longueur d’onde.
Cette limite, appelée limite de résolution, a été
La nanophotonique


















