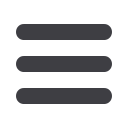
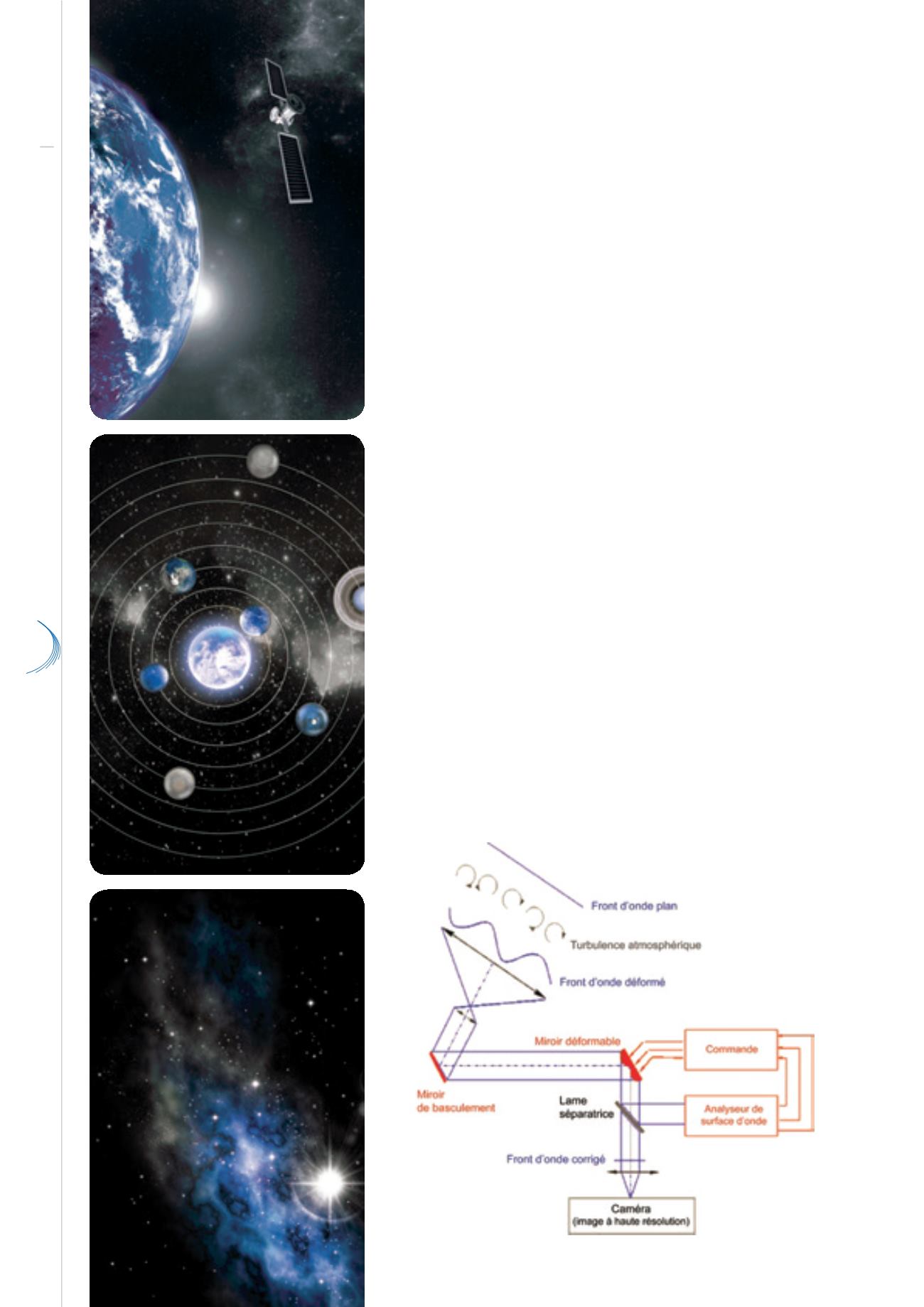
35 36
32
La Lettre
© Nmedia - Fotolia
© destina - Fotolia
© mozZz - Fotolia
Principes de l’optique adaptative
© Pierre Encrenaz
Quant aux perturbations atmosphériques, les techniques de
compensation sont différentes selon la nature du signal observé.
Pour les longueurs d’ondes radio, le déphasage entre les signaux
reçus par plusieurs radiotélescopes est corrigé par la mesure de
la quantité de vapeur d’eau précipitable dans la ligne de visée,
grâce à un hygromètre spectral infrarouge. On peut également
faire interférer les signaux reçus par des radiotélescopes distants
de plusieurs milliers de kilomètres les uns des autres (Amérique,
Australie, Europe, Inde), obtenant ainsi une résolution spatiale très
élevée, équivalente à celle d’un télescope de très grande dimension,
que l’on ne saurait mécaniquement construire. Dans les domaines
visible et infrarouge, l’optique adaptative permet de corriger le
fameux phénomène de scintillation des étoiles - l’image de l’étoile
est étalée et fluctue sur la rétine de l’observateur ou la caméra
du télescope - et de tirer parti de la résolution spatiale potentielle
de télescopes optiques désormais de plus en plus grands (jusqu’à
près de 40 m de diamètre).
La résolution spectrale des différents capteurs permet, grâce à
leur spectre d’émission ou d’absorption, de détecter la présence
et d’identifier des atomes (hydrogène, carbone, azote, fer, etc.),
molécules et grains de poussière : c’est ainsi que l’on connaît
plus de 200 molécules situées dans les nuages interstellaires - là
où vont se former les étoiles - de notre Galaxie, plus de 80 dans
la coma des comètes, ainsi que la composition des poussières
interstellaires et circumstellaires.


















