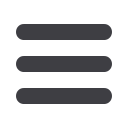
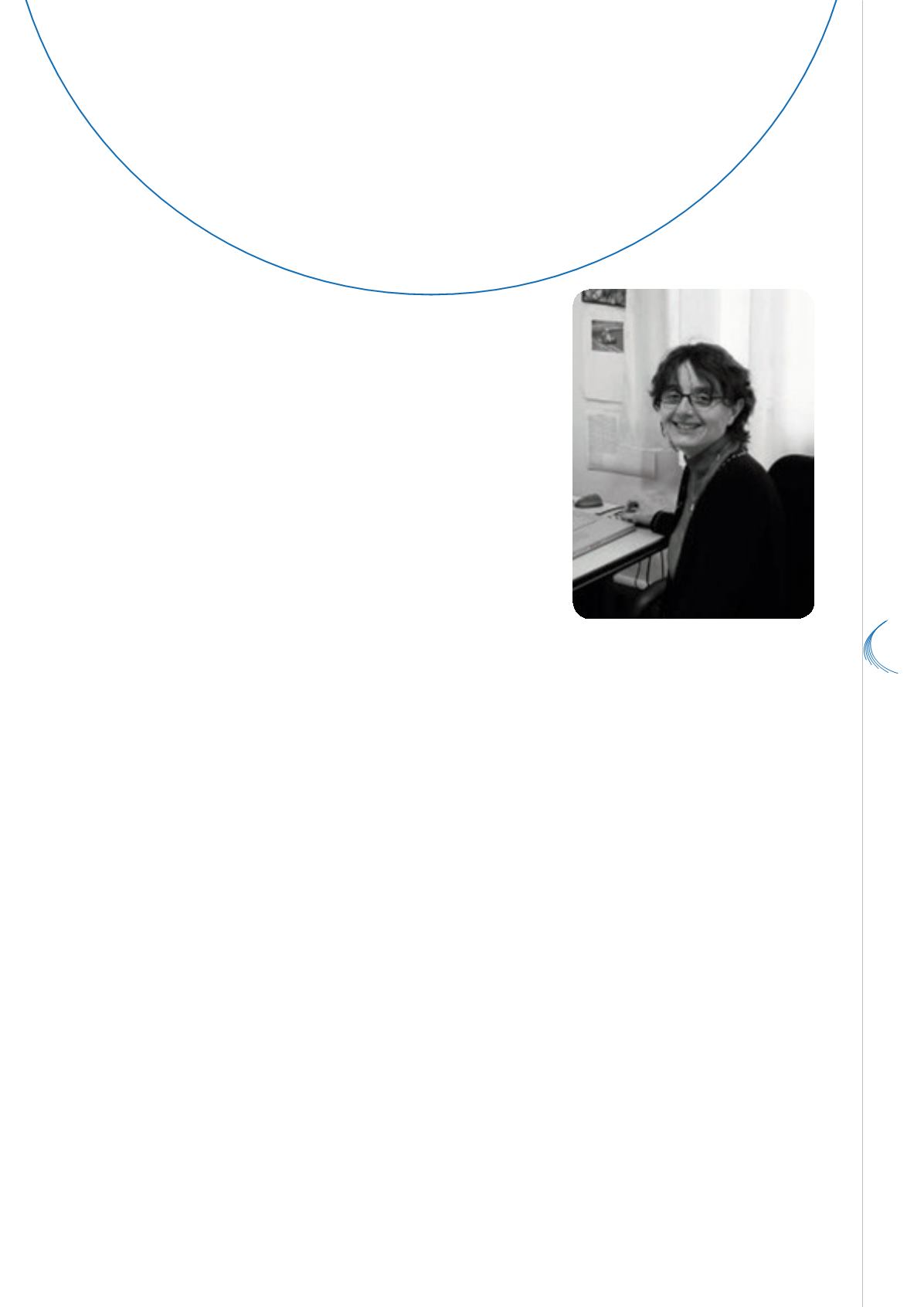
D
ossier
65
La biophotonique, ou comment
la lumière est devenue un outil
diagnostique et thérapeutique
Chantal Andraud
Directrice du laboratoire de chimie, École normale supérieure de
Lyon-CNRS-Université Claude-Bernard
avec Cyrille Monnereau
Laboratoire de chimie, École normale supérieure de Lyon-CNRS-
Université Claude-Bernard
Toute lumière est constituée de photons. Selon le point
de vue adopté, ces photons peuvent être assimilées
à des ondes électromagnétiques ou à des particules
fondamentales porteuses de quantités d’énergie fixes
appelés quantas. Cette énergie peut être mise à profit
dans le cadre de nombreuses applications en relation
avec le biomédical et les biosciences.
Lumière et vivant
Cette énergie est tout d’abord associée à une propriété intrinsèque du photon, sa longueur d’onde.
Après interaction de ce photon avec un dispositif optique, comme un œil, une plaque photographique ou
une caméra, c’est cette longueur d’onde qui va définir la couleur perçue par le dispositif. La gamme de
longueurs d’onde accessibles au dispositif varie en fonction de la nature de ce dernier. Pour l’œil humain,
cette gamme se situe dans un domaine compris entre le bleu-violet (400 nm) et le rouge (800 nm). De part
et d’autre de ces valeurs sont définis les domaines des hautes énergies, les ultraviolets, et des basses
énergies, les infrarouges. Cette gamme de longueurs d’onde ne constitue toutefois qu’une partie infime
du spectre électromagnétique
Aux deux autres extrémités du spectre électromagnétique, les très énergétiques rayons X et les
radiofréquences sont également utilisés dans le domaine biomédical. Les premiers, découverts par
Rontgen en 1895, traversent facilement les tissus biologiques, mais sont efficacement absorbés par les
substances minérales contenues dans les os. Bien qu’invisibles, ils impriment efficacement une plaque
photographique : c’est ce principe qui est utilisé dans la radiographie, notamment. Les seconds, lorsqu’ils
sont utilisés à une longueur d’onde appropriée, interagissent avec les électrons des molécules d’eau,
perturbant momentanément leurs propriétés magnétiques. Le signal engendré par cette perturbation
produit un contraste dépendant de la concentration en eau des différents tissus, permettant donc de les
imager.
© DR


















