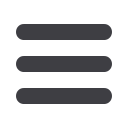
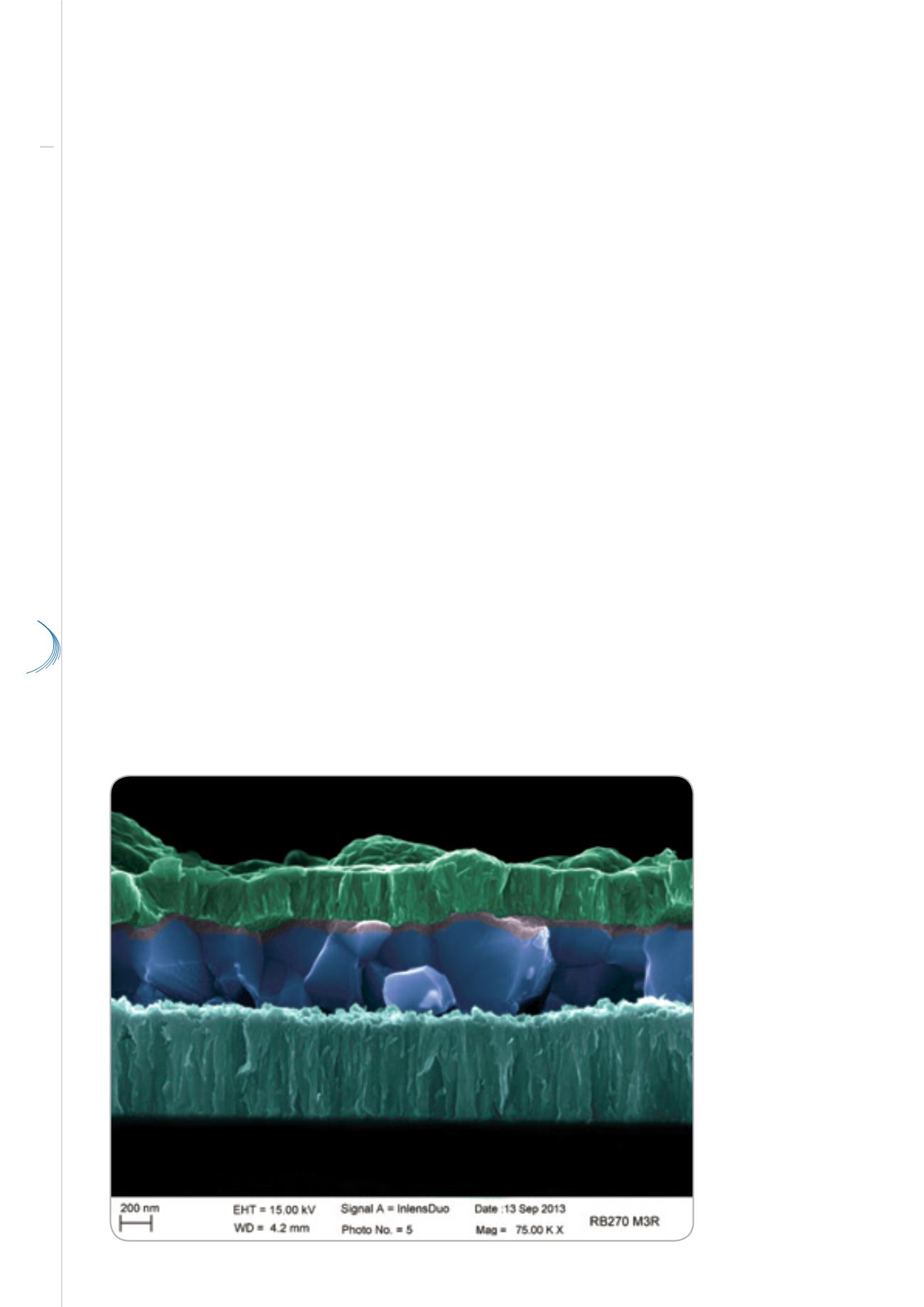
35 36
56
La Lettre
© Benoît Roman IRDEP (2013) - Échantillon préparé par Jorge Posada
une réaction d’oxydoréduction, il convient tout d’abord de séparer l’électron et le trou. Pour que cette
dissociation soit spontanée à température ambiante, le matériau doit posséder une constante diélectrique
haute, permettant d’écranter et de diminuer l’interaction électrostatique entre l’électron et le trou
2
. Cette
séparation de l’électron et du trou est difficile dans le cas de certains systèmes moléculaires ou solides,
ce qui exclut leur utilisation comme absorbant de la lumière pour des applications en photovoltaïque ou
photocatalyse.
La cellule photovoltaïque
Une fois le trou et l’électron séparés, leur différence de potentiel peut directement être utilisée pour produire
un courant électrique : on a alors réalisé une cellule photovoltaïque. Ces cellules sont classiquement
construites à partir d’un matériau semiconducteur de type silicium. La chimie joue un rôle double dans ce
type d’applications.
Elle propose des solides absorbant de la lumière alternatifs aux semiconducteurs classiques. Ainsi, les
matériaux organiques légers et flexibles ouvrent des applications nouvelles
3
. Les matériaux inorganiques
permettent, quant à eux, de réaliser des dispositifs sous forme de films minces et des préparations plus
simples de la cellule par dépôt électrochimique. On peut notamment souligner la famille de matériaux
chalcogénures Cu(In,Ga)Se
2
, qui présente un avantage majeur par rapport au silicium
4
. Alors que le
silicium doit être très pur, avec très peu de défauts, pour que la cellule photovoltaïque soit efficace,
le chalcogénure métallique Cu(In,Ga)Se
2
présente une grande tolérance aux défauts. Il peut donc être
produit sous forme de couches minces par des méthodes électrochimiques beaucoup moins complexes
que les techniques de préparation du silicium.
Coupe en microscopie
électronique d’une cellule
CIGS en couches minces
La couche du bas (verte) est en
molybdène et la couche centrale
(bleue) en Cu(In,Ga)Se
2
. Viennent
ensuite une couche interfaciale de
CdS puis, au-dessus, une couche
de ZnO. La lumière entre dans la
couche de ZnO. Ce type de cellule
donne actuellement un rendement
record de 21,7 % pour cette famille
de matériaux, très proche du
rendement des cellules au silicium
(27 % ). CIGS : Cu(In,Ga)Se
2


















