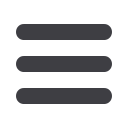
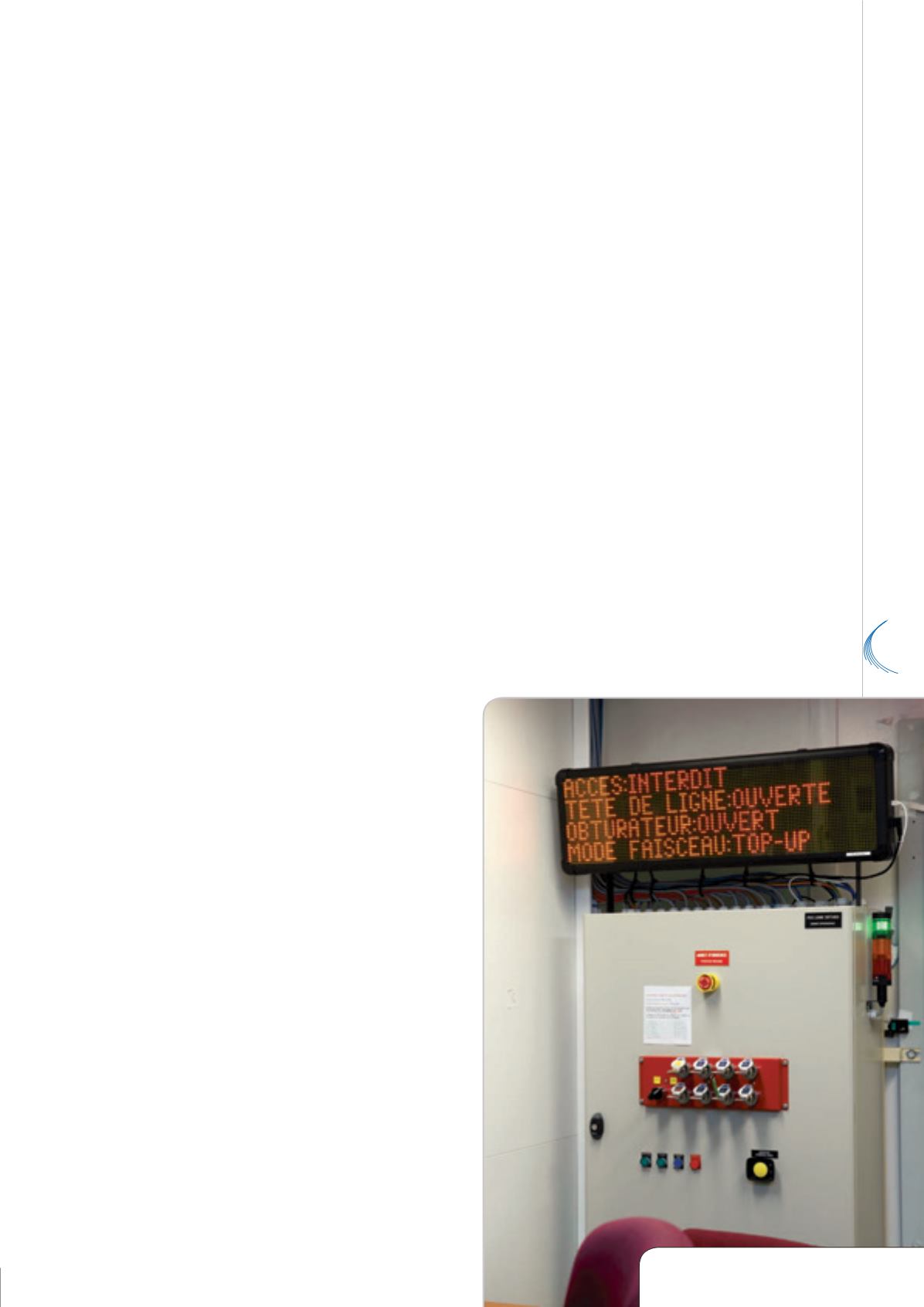
D
ossier
75
© Zabou Carrière
À chaque ligne son dispositif de sécurité.
Ici, l’accès au faisceau est interdit
heures de faisceau, et 10 % du temps est alloué à des recherches à caractère industriel. Plus qu’un seul
soutien technique, les chercheurs de Soleil offrent souvent une véritable collaboration, qui commence
dès la définition du projet et s’étend à l’analyse complexe des données. Ces projets sollicitent les qualités
propres du faisceau : brillance extrême, stabilité et haute résolution temporelle.
Pour Andrew Thompson, ce sont ces qualités, précisément, qui sont recherchées en biologie et médecine :
«
elles permettent d’étudier la structure moléculaire d’un matériau vivant, ses mécanismes cellulaires,
l’organisation de ses tissus.
» Deux lignes sont ainsi dédiées à la cristallographie qui, par diffraction des
rayons X sur le nuage électronique, permet de connaître l’organisation des atomes d’une molécule en
trois dimensions. Le détecteur, en bout de ligne, relève les moindres détails d’un échantillon de quelques
microns ! «
Ce détecteur, c’est le nerf de la guerre
», sourit Paul Morin, les yeux tournés vers des boîtes
d’échantillons expédiées de Cambridge, le berceau de la cristallographie des macromolécules. Parmi les
réussites de Soleil, une collaboration avec l’Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire
(IGBMC) a permis de déterminer, sur une levure, la structure atomique du ribosome eucaryote et des
molécules pouvant l’inhiber
1
. Cette machinerie, d'un poids moléculaire de plus de 3 millions de daltons, est
responsable de la traduction du code génétique. «
Ces connaissances sont précieuses
, commenteAndrew
Thompson :
les antibiotiques à large spectre bloquent souvent le ribosome bactérien, l’empêchant de
synthétiser des protéines, mais peuvent aussi bloquer notre propre ribosome !
» Outre la cristallographie,
d’autres techniques permettent d’examiner la structure atomique de la matière, telle la diffusion aux petits
angles qui permet d’obtenir, par rayons X, une distribution statistique de morphologie et de distance entre
particules d’un échantillon en solution. Beaucoup de lignes dédiées à la biologie sont automatisées : un
bras robotique prélève dans l’azote liquide, en un
temps très court, un grand nombre d’échantillons
de poids extrêmement réduit.
Au niveau cellulaire, plusieurs lignes utilisent
la fluorescence X, un balayage infrarouge
ou, spécificité de Soleil, le rayonnement
ultraviolet. Depuis 2013, un grand partenariat
européen
public-privé,
IMI-Translocation
,
étudie par spectroscopie UV la résistance aux
antibiotiques : la concentration de certains
antibiotiques dans une cellule répond aux UV
lointains (jusqu’à 180 nm), par fluorescence, et
leur transport à travers la membrane cellulaire y
devient en même temps visible, sans marqueur
chimique. Par ailleurs, la première évaluation par
infrarouge du taux de stéatose d’un foie humain
a également été réalisée à Soleil, par une équipe
de l’Inserm et de l’hôpital Brousse : cet excès de


















