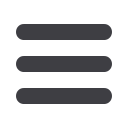
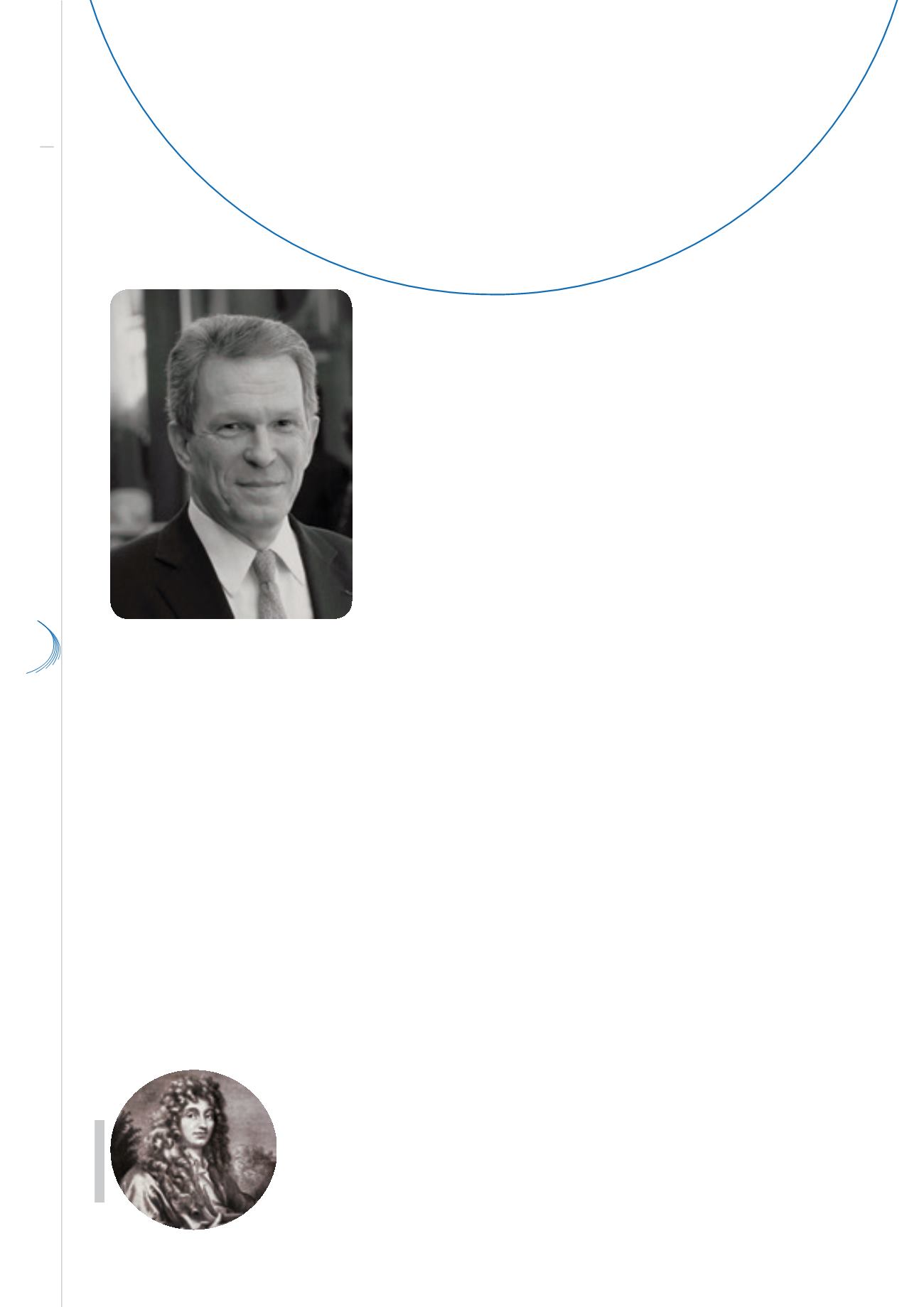
35 36
8
La Lettre
© B.Eymann - Académie des sciences
Christiaan Huygens
© Juulijs - Fotolia
Christian J. Bordé
Membre de l’Académie des sciences, Laboratoire de
physique des lasers, UMR 7538 CNRS, Université Paris Nord,
Villetaneuse - LNE-SYRTE, UMR 8630 CNRS, Observatoire de
Paris
C’est la lumière qui nous permet de découvrir le monde
qui nous entoure. Quelles sont ses limites, et donc les
nôtres ? Explorer nos frontières grâce à la lumière, tel
est le fil conducteur de la première partie de ce dossier.
Beaucoup de terres inconnues subsistent dans
notre univers physique : une liste non exhaustive de
domaines au-delà de nos horizons actuels et où la
lumière joue un rôle-clé sera donnée à la fin de cet
exposé introductif. Les contributions qui suivent, quant à elles, porteront sur les confins de l’espace
et du temps que sont l’infiniment petit, l’infiniment grand, l’infiniment court et l’infiniment durable,
élargissant ainsi le débat pascalien sur les deux infinis aux quatre dimensions de l’espace-temps.
Mais d’abord, la lumière : quel est cet outil merveilleux ? Quelle est sa nature, quelles sont ses
propriétés, comment l’améliorer pour mieux l’utiliser ? Qu’est ce qui est visible, qu’est ce qui ne l’est
pas ? Pour toute cette discussion, nous ferons le parallèle entre lumière et gravitation, qui constituent
nos deux principaux outils d’appréhension et de connaissance du monde extérieur.
Sur la vraie nature de la lumière...
La nature de la lumière a toujours été un objet de fascination pour le physicien, mais aussi de controverses
entre les tenants d’une description corpusculaire et ceux d’une description ondulatoire.
Bref historique
C’est d’abord Isaac Newton (Opticks, 1704) qui va imposer la thèse
d’une lumière constituée de particules. Dans l’autre camp, on trouve
d’autres grands noms de la physique : Christiaan Huygens (Traité de
la lumière, 1690), Thomas Young (figure de diffraction de deux fentes,
1801), Augustin Fresnel (1819), François Arago, James Clerk Maxwell
La lumière
à la conquête des extrêmes


















