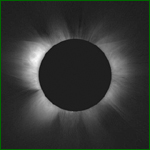![]() es astronomes, avec Jean-François Denisse qui préside le CNES de 1967 à 1973, se saisissent donc immédiatement de ces nouvelles possibilités d’observation par fusées et satellites, qui donnent accès à l’ensemble du spectre électromagnétique : dans le domaine ultraviolet, Georges Courtès et Marcel Golay observent galaxies et étoiles. Plus tard c’est l’accès au domaine infrarouge, alors quasi-totalement inconnu et dont Jean-Claude Pecker se fait l’avocat : Pierre Léna, puis surtout Catherine Cesarsky préparent puis mettent en œuvre la participation française au premier satellite européen observant l’infrarouge (Infrared Space Observatory ISO, 1995), dont les résultats majeurs sont exploités par elle-même et par Jean-Loup Puget ; ils révéleront l’intense activité de formation d’étoiles par les galaxies dans leur passé lointain. De nouveaux laboratoires naissent en France (Saclay, Toulouse), qui vont susciter des missions spatiales pour observer les rayons cosmiques (à la suite des travaux de Pierre Auger et Louis Leprince-Ringuet, puis plus tard des interprétations de Catherine Cesarsky), le rayonnement gamma ou X, en développant d’importantes collaborations internationales, notamment avec les chercheurs soviétiques. Dans l’espace, l’existence de gaz sous forme de plasmas, qu’ils soient proches comme dans la magnétosphère terrestre et la couronne solaire, ou lointains comme ceux du milieu interstellaire, offre aux physiciens des laboratoires naturels dont les conditions ne peuvent être réalisées sur Terre. L’étude de ces plasmas spatiaux va inspirer les travaux de Michel Petit, René Pellat, Guy Laval, pour conduire à de grandes missions spatiales européennes, tant pour l’étude du Soleil (SOHO) que pour ce qui s’appelle désormais la météorologie de l’espace (missions CLUSTER, STEREO). L’astrométrie bénéficie aussi de l’espace avec la mission européenne HIPPARCOS (1989), née d’un concept imaginé par Pierre Lacroute et qui connaît un grand succès, déterminant la position de 120.000 étoiles à la précision de 2 millisecondes d’angle, donnant ainsi mouvements propres et parallaxes.
es astronomes, avec Jean-François Denisse qui préside le CNES de 1967 à 1973, se saisissent donc immédiatement de ces nouvelles possibilités d’observation par fusées et satellites, qui donnent accès à l’ensemble du spectre électromagnétique : dans le domaine ultraviolet, Georges Courtès et Marcel Golay observent galaxies et étoiles. Plus tard c’est l’accès au domaine infrarouge, alors quasi-totalement inconnu et dont Jean-Claude Pecker se fait l’avocat : Pierre Léna, puis surtout Catherine Cesarsky préparent puis mettent en œuvre la participation française au premier satellite européen observant l’infrarouge (Infrared Space Observatory ISO, 1995), dont les résultats majeurs sont exploités par elle-même et par Jean-Loup Puget ; ils révéleront l’intense activité de formation d’étoiles par les galaxies dans leur passé lointain. De nouveaux laboratoires naissent en France (Saclay, Toulouse), qui vont susciter des missions spatiales pour observer les rayons cosmiques (à la suite des travaux de Pierre Auger et Louis Leprince-Ringuet, puis plus tard des interprétations de Catherine Cesarsky), le rayonnement gamma ou X, en développant d’importantes collaborations internationales, notamment avec les chercheurs soviétiques. Dans l’espace, l’existence de gaz sous forme de plasmas, qu’ils soient proches comme dans la magnétosphère terrestre et la couronne solaire, ou lointains comme ceux du milieu interstellaire, offre aux physiciens des laboratoires naturels dont les conditions ne peuvent être réalisées sur Terre. L’étude de ces plasmas spatiaux va inspirer les travaux de Michel Petit, René Pellat, Guy Laval, pour conduire à de grandes missions spatiales européennes, tant pour l’étude du Soleil (SOHO) que pour ce qui s’appelle désormais la météorologie de l’espace (missions CLUSTER, STEREO). L’astrométrie bénéficie aussi de l’espace avec la mission européenne HIPPARCOS (1989), née d’un concept imaginé par Pierre Lacroute et qui connaît un grand succès, déterminant la position de 120.000 étoiles à la précision de 2 millisecondes d’angle, donnant ainsi mouvements propres et parallaxes.