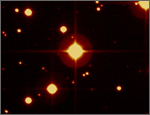râce aux grandes missions spatiales d’exploration du système solaire – essentiellement conduites par la NASA –, qui débutent avec le programme lunaire APOLLO et se poursuivent par l’exploration de Mars et de Vénus, par les sondes envoyées vers Jupiter et Saturne, la planétologie connaît une phase d’extraordinaire croissance, où l’astronomie rejoint la géologie et la géophysique, comme le montrent les travaux de géochimie de Claude Allègre. La section de l’Académie des sciences où siègent les astronomes, dénommée Sciences de l’univers, illustre bien cette convergence d’intérêts et de méthodes. Même si l’essentiel des missions planétaires est conduit par les États-Unis ou l’Union soviétique, Jacques Blamont peut susciter l’envoi de ballons-sondes dans l’atmosphère de Vénus. L’étude de la formation du système solaire bénéficie largement de ces explorations, par le partage international des résultats auxquels les Français ont donc accès. Une communauté extrêmement vivante de planétologues émerge en France, laquelle est par exemple à l’origine du dépôt, en 1988, de la sonde HUYGHENS à la surface de Titan, satellite de Saturne : le point d’impact sera dénommé Hubert Curien, en hommage à l’un des pères de l’Europe spatiale.
râce aux grandes missions spatiales d’exploration du système solaire – essentiellement conduites par la NASA –, qui débutent avec le programme lunaire APOLLO et se poursuivent par l’exploration de Mars et de Vénus, par les sondes envoyées vers Jupiter et Saturne, la planétologie connaît une phase d’extraordinaire croissance, où l’astronomie rejoint la géologie et la géophysique, comme le montrent les travaux de géochimie de Claude Allègre. La section de l’Académie des sciences où siègent les astronomes, dénommée Sciences de l’univers, illustre bien cette convergence d’intérêts et de méthodes. Même si l’essentiel des missions planétaires est conduit par les États-Unis ou l’Union soviétique, Jacques Blamont peut susciter l’envoi de ballons-sondes dans l’atmosphère de Vénus. L’étude de la formation du système solaire bénéficie largement de ces explorations, par le partage international des résultats auxquels les Français ont donc accès. Une communauté extrêmement vivante de planétologues émerge en France, laquelle est par exemple à l’origine du dépôt, en 1988, de la sonde HUYGHENS à la surface de Titan, satellite de Saturne : le point d’impact sera dénommé Hubert Curien, en hommage à l’un des pères de l’Europe spatiale.