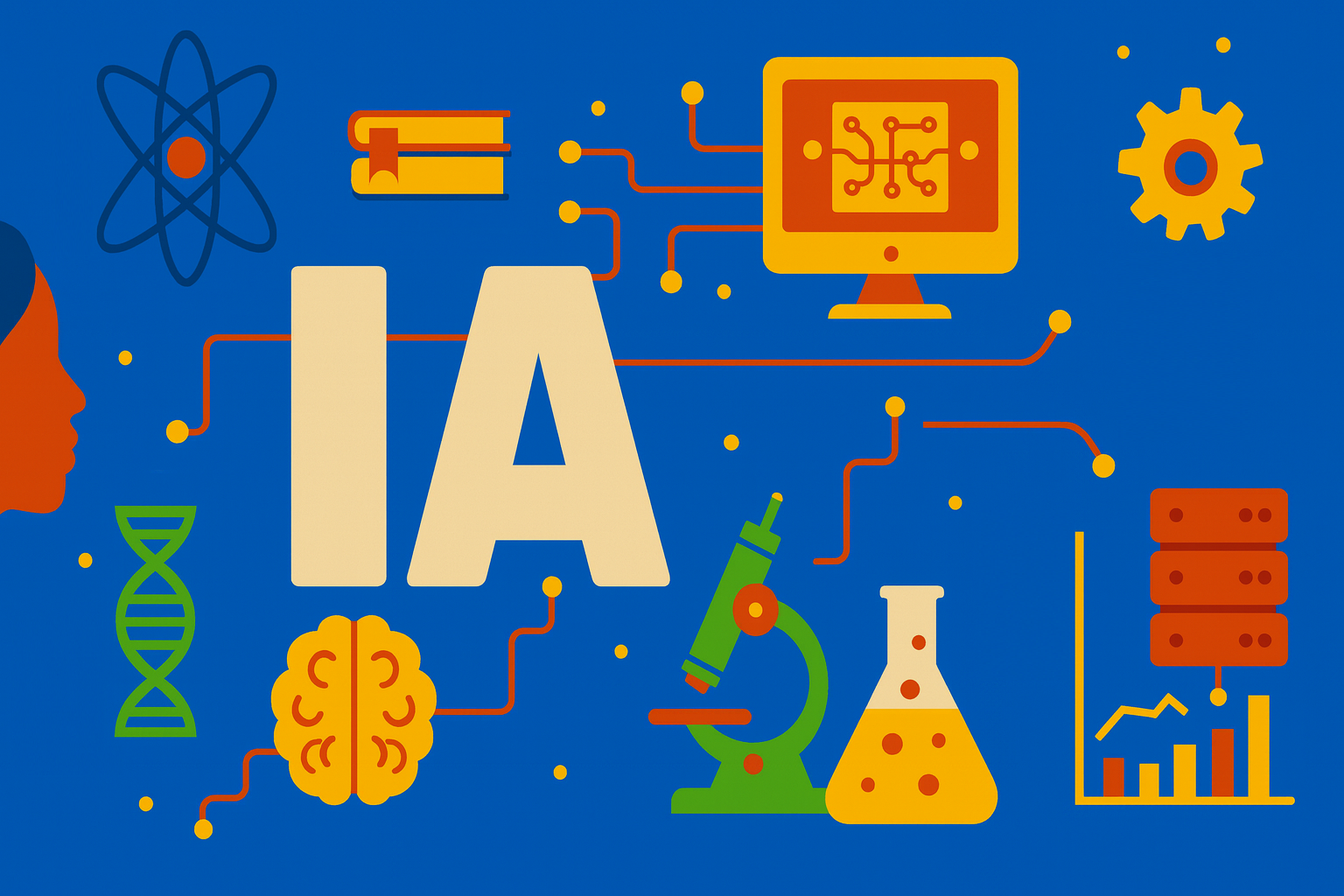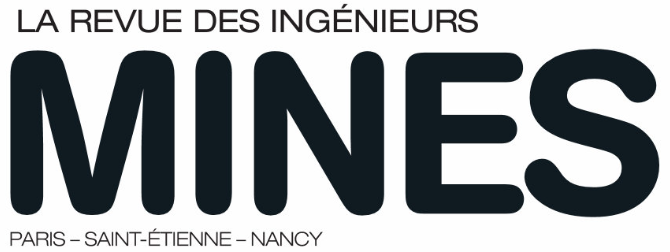Actualités & événements de l'Académie des sciences
À la une
Médias
Voir toutPodcasts Petites histoires de science

L’Académie des sciences lance sa première série de podcasts en partenariat avec Canal Académies. Au micro, Étienne Ghys, l’un de ses deux secrétaires perpétuels.
Replay émission Arte (28') avec Françoise Combes

Françoise Combes, présidente de l’Académie des sciences, était l’invitée d’Élisabeth Quin sur Arte la semaine dernière. Une discussion passionnante sur l’actualité scientifique, les avancées de la recherche et les grands défis à venir.
La lettre d'information de l'Académie des sciences
Une fois par mois, soyez informé des dernières actualités de l'académie , de ses prochains événements, des nouvelles sorties médias, des dernières parutions de publications...
Votre adresse de messagerie sera exclusivement utilisée pour l'envoi de nos lettres d'information, conformément à notre politique de confidentialité et de traitement des données personnelles.
Vous pourrez vous désabonner à tout moment en cliquant sur le lien prévu à cet effet dans chaque newsletter.