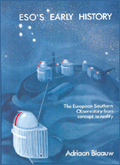![]() ès 1962, cinq pays européens, dont la France avec Charles Fehrenbach, ont rassemblé leurs forces pour créer une organisation, l’European Southern Observatory (ESO) et un observatoire dans l’hémisphère Sud au Chili, complétant les instruments nationaux installés au Nord. Progressivement et particulièrement sous l’impulsion de Lodewijk Woltjer dès 1975, l’ESO focalise les efforts européens et inaugure en 1998 le Very Large Telescope (VLT), l’un des plus puissants observatoires optiques au monde, avant de préparer dès la décennie suivante un successeur de 42 mètres de diamètre, appelé European-Extremely Large Telescope (E-ELT) et qui pourrait être réalisé avant 2020. Dans l’hémisphère Nord, la France s’associe au Canada et à l’Université d’Hawaii pour construire le télescope optique de 3,6 m Canada-France-Hawaii (CFHT) sur le remarquable site du Mauna Kea : ce bel instrument découvre les arcs gravitationnels et le lithium d’origine primordiale. Outre l’évolution du diamètre des télescopes, la technologie raffine aussi les détecteurs de lumière : avant l’arrivée révolutionnaire des Charge Coupled Device (CCD) à partir de 1980, la caméra électronique d’André Lallemand, perfectionnée par Gérard Wlérick, contribue à l’observation des quasars (nodosités du jet de 3C120) au télescope CFHT.
ès 1962, cinq pays européens, dont la France avec Charles Fehrenbach, ont rassemblé leurs forces pour créer une organisation, l’European Southern Observatory (ESO) et un observatoire dans l’hémisphère Sud au Chili, complétant les instruments nationaux installés au Nord. Progressivement et particulièrement sous l’impulsion de Lodewijk Woltjer dès 1975, l’ESO focalise les efforts européens et inaugure en 1998 le Very Large Telescope (VLT), l’un des plus puissants observatoires optiques au monde, avant de préparer dès la décennie suivante un successeur de 42 mètres de diamètre, appelé European-Extremely Large Telescope (E-ELT) et qui pourrait être réalisé avant 2020. Dans l’hémisphère Nord, la France s’associe au Canada et à l’Université d’Hawaii pour construire le télescope optique de 3,6 m Canada-France-Hawaii (CFHT) sur le remarquable site du Mauna Kea : ce bel instrument découvre les arcs gravitationnels et le lithium d’origine primordiale. Outre l’évolution du diamètre des télescopes, la technologie raffine aussi les détecteurs de lumière : avant l’arrivée révolutionnaire des Charge Coupled Device (CCD) à partir de 1980, la caméra électronique d’André Lallemand, perfectionnée par Gérard Wlérick, contribue à l’observation des quasars (nodosités du jet de 3C120) au télescope CFHT.