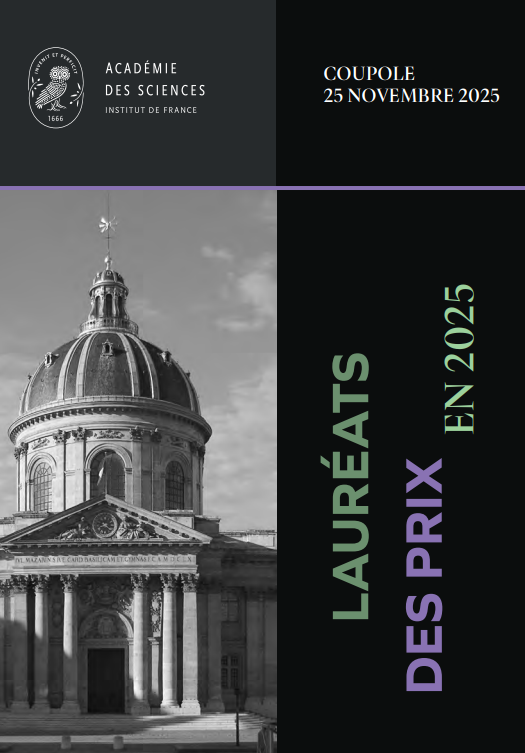Prix & médailles
L'Académie récompense l'excellence scientifique, célèbre les contributions remarquables dans divers domaines et honore les innovations et leurs impacts sur les sciences et sur la société, à travers une variété de distinctions prestigieuses.
©Mathieu Baumer
Célébrer l'excellence scientifique
Grâce à la générosité de donateurs privés, d’organismes d’État ou d’entreprises, l’Académie des sciences remet, chaque année, près de 80 prix couvrant l’ensemble des domaines scientifiques, aussi bien fondamentaux qu’appliqués.
De nombreux candidats d’excellence sont considérés pour ces prix. Leur sélection est opérée par des jurys fonctionnant dans le cadre d’un règlement excluant la possibilité de conflits d’intérêt. Les jurys des prix d’un montant inférieur à 7.500 €, dits "prix thématiques de l’Académie des sciences", sont constitués par les membres des sections compétentes.
Les "grands prix", d’un montant supérieur à 15.000 €, relèvent de jurys spécifiques, associant des membres de plusieurs sections ou extérieurs à l’Académie, si nécessaire.
Tous ces prix sont remis aux lauréats au cours de séances solennelles sous la coupole de l’Institut de France.
Présentation de l’Académie