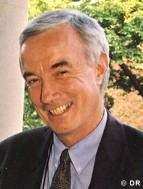Les académiciens
Découvrez les parcours et travaux des éminents scientifiques français et internationaux qui constituent notre communauté. Chaque membre apporte son expertise unique dans divers domaines, contribuant à la richesse des échanges et à l’avancement de la science.

© Mathieu Baumer
L'élection des académiciens/académiciennes
Les académicien(ne)s sont élu(e)s à vie, à l’issue d’un processus rigoureux s’échelonnant sur près d’un an. L’ouverture d’une session d’élection est décidée en début d’année. La moitié au moins des sièges à pourvoir est réservée à des candidats âgés de moins de 55 ans au 1er janvier de l’année d’élection. Les candidatures ne peuvent être proposées que par des membres de l’Académie.
La commission électorale arrête la liste finale des candidats à chaque poste et les affecte à une commission de mise en lignes. Chaque candidat y est présenté par son « présentateur », qui le défend, et par un « rapporteur », qui donne un éclairage plus distancié. Chaque commission délibère ensuite et vote une première fois, pour inscrire en « première ligne » la personnalité ayant obtenu la majorité des suffrages, puis une seconde, pour le candidat qui sera présenté « en seconde ligne ».
Les préconisations de l’ensemble des commissions sont ensuite présentées au comité secret, instance réunissant l’ensemble des membres de l’Académie, qui procède au vote final, pour chaque poste. Les résultats sont alors soumis pour approbation au président de la République. Les nouveaux membres sont officiellement nommés à la publication du décret au Journal officiel.
Une large communauté
Aujourd'hui l'Académie des sciences compte un large nombre de membres, associés étrangers et correspondants élus parmi les scientifiques les plus éminents à l'échelle mondiale, affirmant son caractère pluridisciplinaire et son ouverture internationale.
QUELQUES CHiffres clés
-
305Membres de l'Académie
-
112Associés étrangers
-
57Correspondants
Ils remplissent leur mission principalement au sein de comités thématiques, essentiels pour le conseil et l’expertise de l’Académie.
Les axes d’intervention et les choix stratégiques de l’Académie sont décidés par les Secrétaires perpétuels, qui se basent sur plusieurs instances de gouvernance : l’Assemblée plénière des académiciens (ou Comité secret), le Comité restreint, le Bureau et trois délégations (Relations internationales, Information scientifique et communication, Éducation et formation).